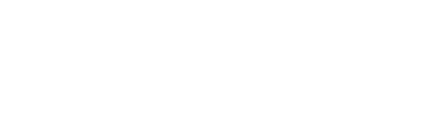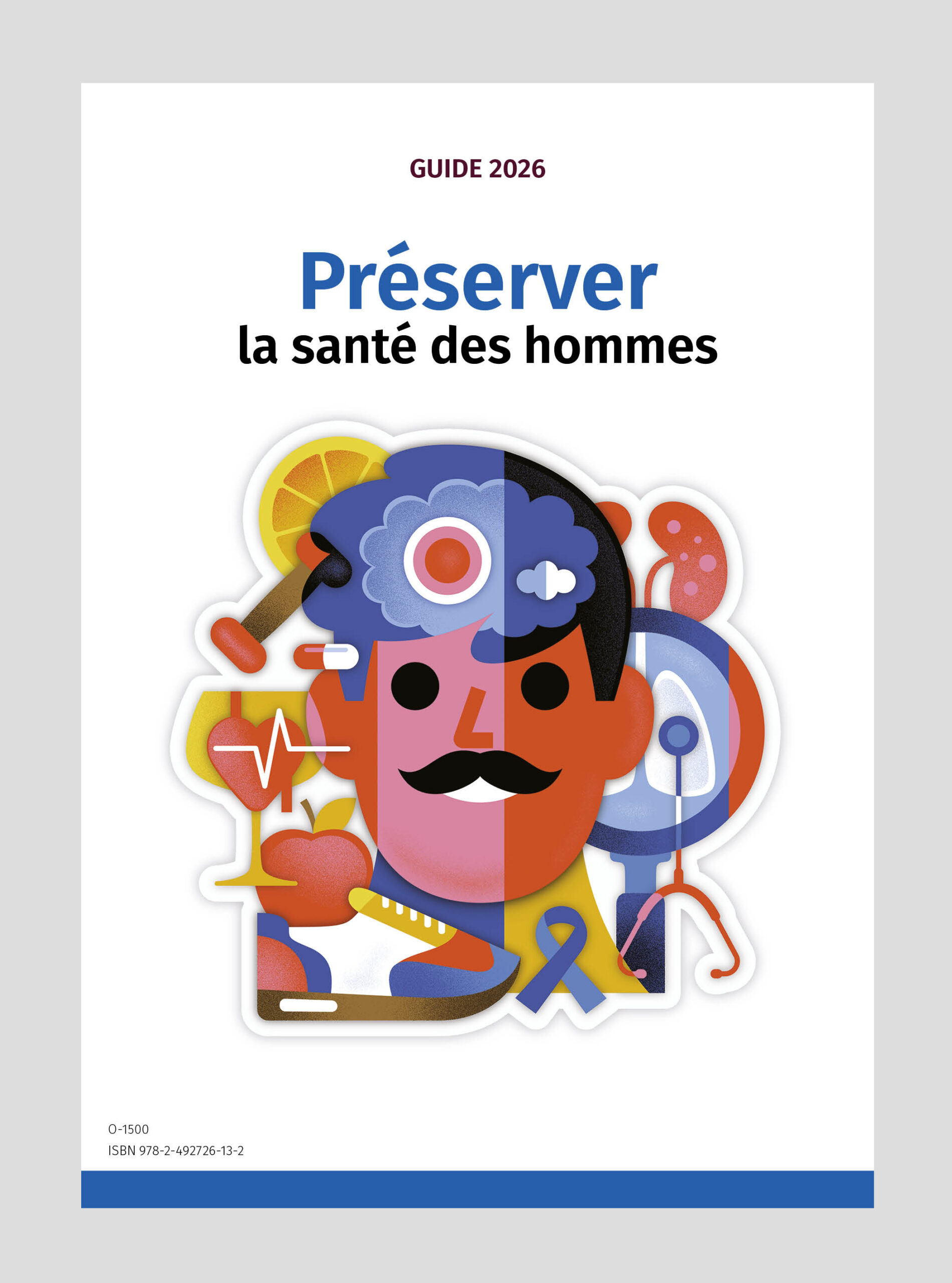Aides auditives : la France bonne élève grâce au 100 % santé
Quatre ans après l’instauration du dispositif 100 % santé en audiologie, la France enregistre une forte progression du taux d’équipement des personnes malentendantes. Ce résultat place l’Hexagone en tête des pays européens, tout en maintenant un niveau de satisfaction élevé.
Selon l’étude EuroTrak 2025 (en anglais) qui compare les déficiences auditives et les appareils dans les différents pays européens, la France fait figure de bonne élève. Elle se hisse désormais « parmi les pays européens ayant les meilleurs taux de personnes appareillées », se réjouit le Syndicat des audioprothésistes (SDA) dans un communiqué. Un succès qui s’explique principalement grâce à la réforme 100 % santé audiologie, qui propose aux Français une offre d’aides auditives sans reste à charge.
Une nette progression du taux d’équipement en aides auditives
Depuis le lancement du 100 % santé audiologie début 2021, la part des personnes malentendantes (lire aussi notre article) équipées est passée à 55,5 %, soit une augmentation de près de 10 points en trois ans. L‘Allemagne aussi voit son taux augmenter, mais de façon moins importante. À l’inverse du Royaume-Uni qui enregistre pour la première fois un recul avec seulement 50,5 % de taux d’équipement, contre 52,8 % en 2022.
Cette performance française s’inscrit dans un contexte européen contrasté. En cause : des modèles d’organisation différents, comme l’explique l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé dans son document : « en Suède et en Angleterre, le secteur public assure un achat centralisé par un système d’appel d’offre (…) mais cette solvabilisation se fait au prix d’une offre réduite et de phénomènes de files d’attente. (…) Longues files d’attente dans les systèmes publics : 12 mois en Angleterre ; entre 3 et 24 mois en Suède » En revanche, le modèle français, fondé sur l’accessibilité et le libre choix, semble porter ses fruits.
Les Français particulièrement satisfaits de leurs équipements
Outre l’accès, la satisfaction des personnes équipées est également un indicateur clé. Et là aussi, la France se démarque. Elle atteint 83 %, un des taux les plus élevés d’Europe. « Et comme ce sont les mêmes aides auditives dans tous les pays, c’est sans doute l’audioprothésiste qui fait la différence », se félicite Brice Jantzem, président du SDA.
La distinction entre les équipements de classe 1 (pris en charge à 100 %) et ceux de classe 2 (avec reste à charge) révèle aussi des nuances : les patients en classe 2 affichent un taux de satisfaction de 88 %, contre 82 % pour le 100 % santé. Un écart qui s’explique notamment par la technicité des appareils et l’engagement des patients dans leur parcours de soins.
Préserver et renforcer un modèle vertueux
Le SDA plaide aujourd’hui pour consolider ce modèle performant. Il propose cependant quelques mesures « pour améliorer la qualité et l’effectivité des prestations des audioprothésistes ». Cela passerait d’abord par la création d’un Ordre professionnel afin d’assurer la gestion du tableau des audioprothésistes et d’un code de déontologie. Il recommande aussi un encadrement de la publicité pour les aides auditives. Il appelle de ses vœux un conventionnement plus strict entre l’audioprothésiste et les remboursements de l’Assurance maladie. Procéder à la réingénierie de la formation des audioprothésistes constitue enfin une autre piste à explorer, selon le syndicat.
Les bénéfices de cette politique ne sont pas uniquement individuels. Plus de 4 millions de Français sont aujourd’hui appareillés, réduisant les risques de déclin cognitif, d’isolement social, ou de chute.
L’étude EuroTrak confirme donc le succès du 100 % santé audiologie. Pour le Syndicat des audioprothésistes, ce dernier repose autant sur le financement que sur l’accompagnement humain. Dans un contexte de vieillissement de la population, maintenir un haut niveau d’équipement et d’observance est ainsi essentiel pour la santé publique.