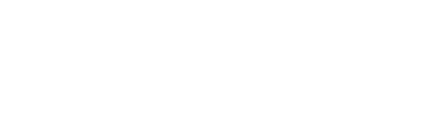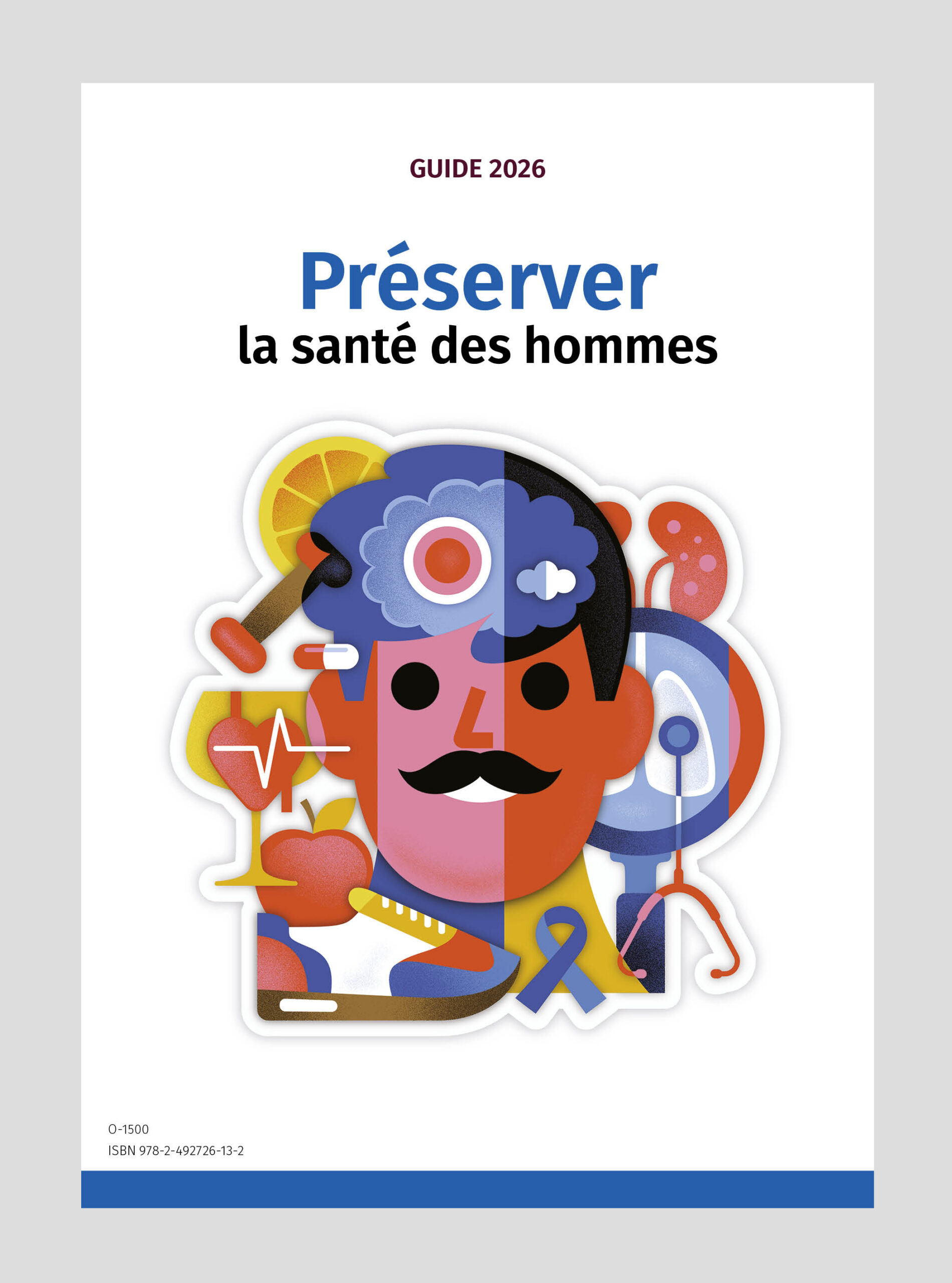Les troubles anxieux sont restés stables malgré la crise sanitaire
Une nouvelle étude s’est intéressée à la prévalence des troubles anxieux chez les adultes en France, entre 2017 et 2021. Résultats : elle n’a pas augmenté. Mais elle est demeurée à un niveau élevé sur cette période.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a provoqué une hausse des dépressions. Mais en est-il de même avec les troubles anxieux ? C’est à cette question qu’a répondu Santé publique France, dans une étude publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) du 22 juillet. « Nos résultats ne montrent pas d’évolution significative de la prévalence des états anxieux entre 2017 et 2021 », ont conclu les auteurs.
Des troubles anxieux fréquents
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus fréquents dans le monde. Ils regroupent plusieurs formes cliniques comme l’anxiété généralisée, sociale, de séparation, le trouble panique, l’agoraphobie et les phobies spécifiques.
« L’anxiété est un phénomène physiologique naturel : en réponse à un danger ou à un stress, le fonctionnement de notre organisme se modifie, avec le plus souvent une accélération du rythme cardiaque, des troubles du sommeil, une augmentation de la transpiration et, parfois, des difficultés à respirer ou une mise en retrait, explique l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), sur son site. En temps normal, ces modifications disparaissent rapidement. Lorsqu’elles deviennent trop intenses ou envahissantes, au point de perturber le quotidien, d’entraîner des arrêts de travail et de générer un sentiment permanent d’insécurité, on parle de trouble anxieux. »
12,5 % d’adultes concernés
Dans le détail, l’étude indique, qu’en 2021, 12,5 % des personnes âgées de 18 à 85 ans en France hexagonale présentaient un état anxieux. Les femmes sont particulièrement touchées (18,2 %, contre 6,4 % des hommes). La tranche d’âge 25-65 ans apparaît, de plus, comme la plus concernée (environ 15 %). Chez les plus de 65 ans, la prévalence est inférieure (environ 7 %). Enfin, les états anxieux ont été observés chez 11,3 % des 18-24 ans.
Finalement, entre 2017 et 2021, leur prévalence est restée stable chez les 18-75 ans. Et ce, « quels que soient le sexe, l’âge (sauf la tranche des 65-75 ans), le niveau d’éducation, la situation professionnelle, la composition du ménage et la situation financière », précisent les auteurs.
Ces derniers ont par ailleurs déterminé que les facteurs associés aux troubles anxieux sont communs aux deux sexes. Ils sont ainsi liés à des situations sociales défavorables (difficultés financières, faible niveau de diplôme), mais surtout, à des épisodes dépressifs et des pensées suicidaires.
L’impact de la crise sanitaire sur la dépression
La pandémie de Covid-19, survenue au début de l’année 2020, a accentué le fardeau mondial des troubles mentaux. En France, entre 2017 et 2021, la prévalence des épisodes dépressifs a significativement augmenté en population générale : + 3,5 points.
S’agissant des troubles anxieux, l’enquête CoviPrev estimait qu’ils concernaient 27 % des adultes en mars 2020 puis 16 % entre mai et juin 2020 (à la fin du premier confinement). En 2021, ce taux était de 23 %. Les écarts observés entre 2020 et 2021 « peuvent s’expliquer par une prévalence plus élevée des états anxieux durant la première année de la pandémie ». Quant aux différences avec l’étude publiée dans le BEH, elles seraient liées aux méthodes utilisées. « Les données […] suggèrent qu’il n’y a pas eu d’augmentation durable des symptomatologies anxieuses en population générale à la suite de l’épidémie de Covid-19 », confirment ainsi les auteurs.
Faciliter l’accès à la prévention et aux soins
Les troubles anxieux représentent toutefois un enjeu majeur de santé publique en France. Ils touchent une part significative de la population. Ils sont aussi associés à des inégalités sociales marquées. Il est donc essentiel de renforcer, d’une part, la prévention, à l’image du dispositif Fil santé jeunes (lire notre article). D’autre part, il convient d’améliorer l’accès à la prise en charge de tous les citoyens. Et cela est d’autant plus capital que la santé mentale a été désignée Grande cause nationale en 2025.