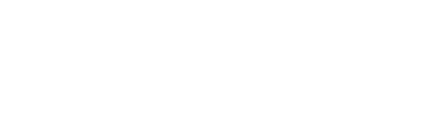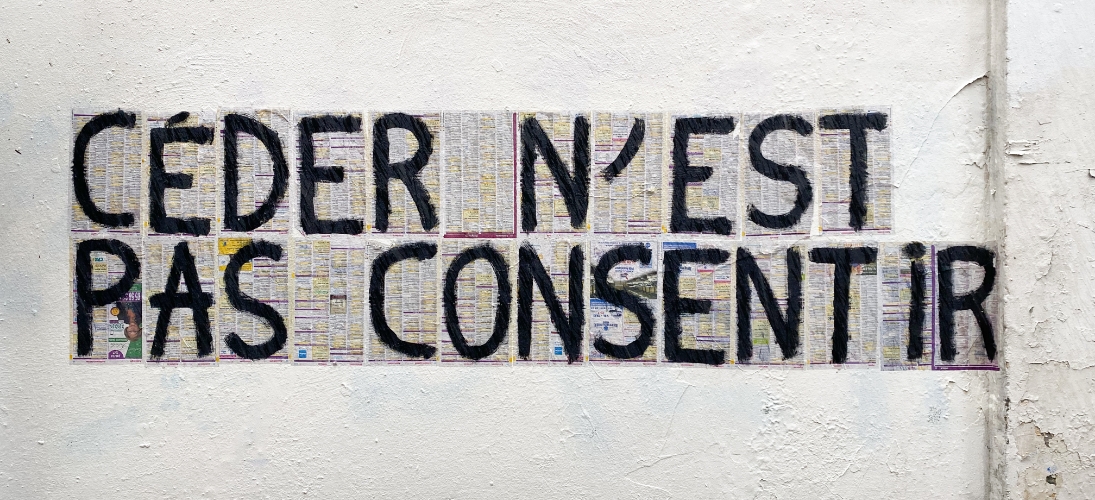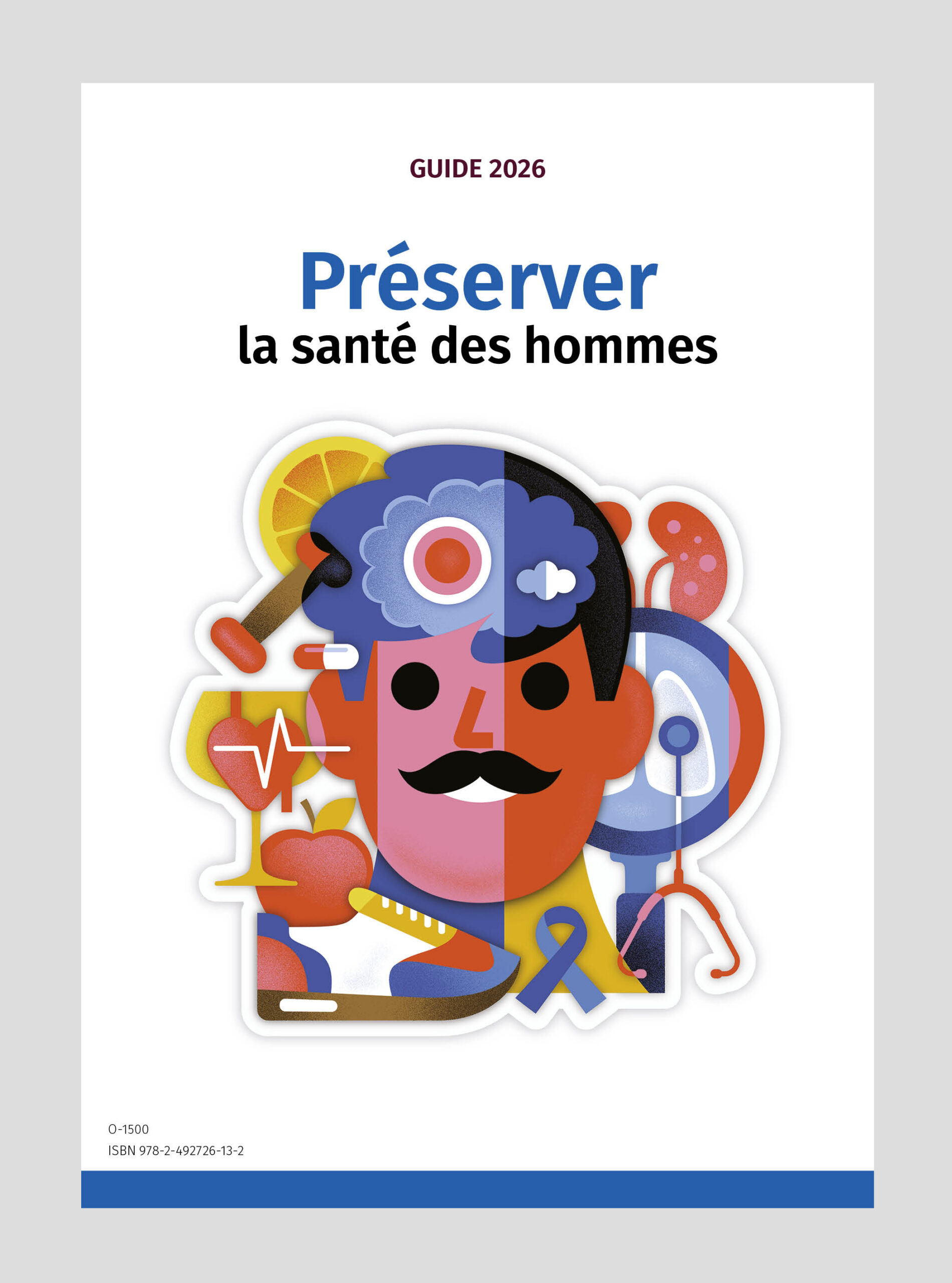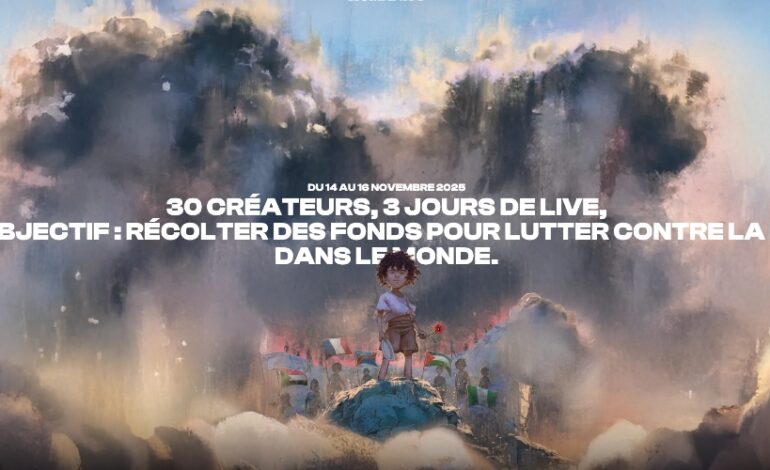Violences sexuelles : le non-consentement entre dans la loi française
La France franchit une étape historique dans la lutte contre les violences sexuelles. Le Parlement a adopté une proposition de loi qui inscrit explicitement dans le Code pénal la notion de non-consentement de la victime.
Le 29 octobre 2025, le Sénat a définitivement adopté à l’unanimité la proposition de loi qui intègre l’absence de consentement de la victime dans la définition du viol et des autres agressions sexuelles. Ce vote succède à celui de l’Assemblée nationale qui a eu lieu le 23 octobre 2025. Le texte constitue une avancée majeure pour la protection des victimes et la reconnaissance de leurs droits. Il s’inscrit dans un contexte où les chiffres des violences sexuelles restent alarmants.
Renforcer la protection des victimes
En 2023, 114 100 victimes de violences sexuelles ont en effet été enregistrées par les forces de l’ordre, selon Info.gouv.fr. En parallèle, 61 606 personnes ont été mises en cause pour de tels actes. Pourtant, seules 6 356 condamnations ont été prononcées cette même année. Un écart qui souligne les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir justice. Il met aussi en avant les lacunes du système judiciaire qui peine à qualifier et sanctionner ces crimes.
La prise en compte du consentement était donc nécessaire pour améliorer la situation. Celle-ci s’inscrit d’ailleurs dans la lignée de mesures déjà prises pour protéger les victimes de violences (lire notre article).
Le non-consentement, une notion désormais claire et précise
La loi définissait jusqu’à présent l’agression sexuelle comme : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi ». La proposition de loi modifie cette définition comme suit : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». Le non-consentement de la victime devient alors le critère central pour la qualifier.
Dans le détail, le nouveau texte précise que le consentement est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». « Il est apprécié au regard des circonstances, est-il ajouté. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. » Enfin, « il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature », est-il également indiqué.
Le consentement doit ainsi être formulé sans contrainte, ni pression. Il ne peut donc exister sous l’emprise de drogues ou d’alcool, ou en situation de vulnérabilité. De plus, le fait de consentir à un acte ne signifie pas que l’on accepte tous les autres actes. De même, exprimer un « oui » une fois ne veut pas dire que l’on soit toujours d’accord.
Élargir la notion de viol
La proposition de loi élargit, par ailleurs, la notion de viol. Celle-ci est caractérisée, dans le Code pénal, comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». La mention des « actes bucco-anaux » sera ajoutée dans la nouvelle version de l’article.
Une avancée attendue…
Ces évolutions répondent à une demande importante, près d’un an après le procès des viols de Mazan. Au total, 51 hommes ont été jugés, fin 2024, pour avoir violé Gisèle Pelicot alors qu’elle était droguée par son propre époux (lire aussi notre article). La question du consentement a alors tenu une place très importante lors des audiences, ce qui a eu pour effet d’amener le sujet dans le débat public.
Mais cette proposition de loi a également soulevé des interrogations. Certains députés et sénateurs ont fait part de leurs réserves ou de leur opposition au texte. Ils craignaient notamment que l’intégration du non-consentement risque de centrer l’enquête sur l’attitude de la victime. Les défenseurs de la mesure ont, à leur tour, argumenté qu’elle permettrait au contraire de mieux appréhender la réalité des agressions sexuelles, souvent marquées par des mécanismes de domination et de manipulation.
… mais qui doit s’accompagner d’autres mesures
Les associations, quant à elle, ont salué ce changement. « Si l’inscription du non-consentement dans la définition pénale du viol est une avancée féministe immense, elle doit s’accompagner de mesures fortes pour véritablement passer d’une culture du viol à une culture du consentement », estime la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles dans un post LinkedIn. Elle réclame également l’augmentation des moyens alloués à la justice.
Amnesty international France est sur la même ligne. « C’est un premier pas pour changer les comportements, considère l’association sur Facebook. Mais beaucoup reste encore à faire pour permettre un accès effectif des victimes à la justice et passer enfin à une culture du consentement. »
Avec l’adoption de cette proposition de loi, la France rejoint les pays qui ont déjà modifié leur législation autour du consentement. C’est le cas du Canada, de la Suède, de l’Espagne ou de la Norvège. Le texte doit encore être publié au Journal officiel pour être officiellement promulgué.