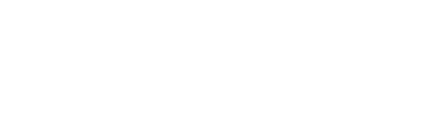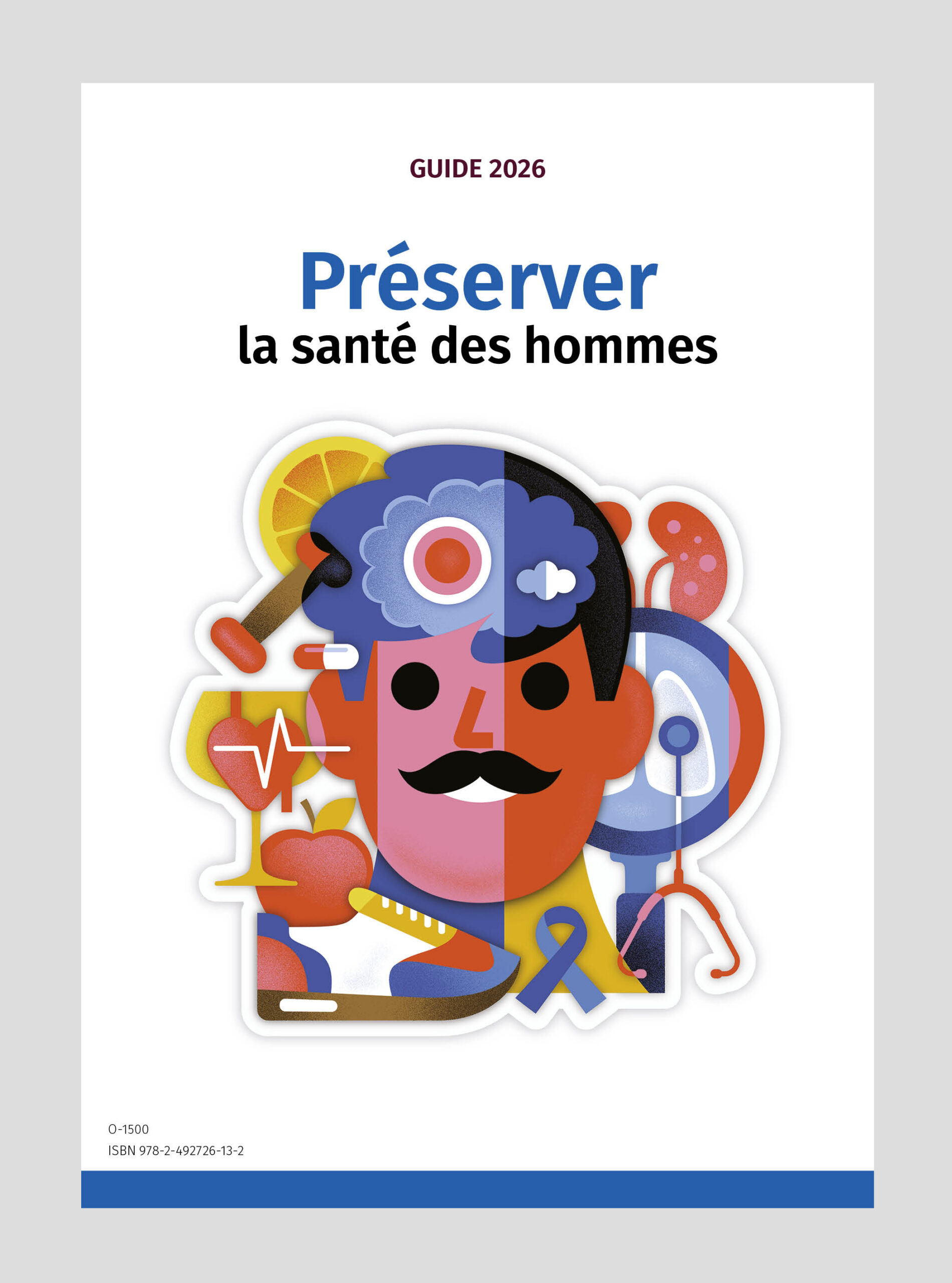Sauvegarde de justice médicale ou judiciaire : de quoi s’agit-il ?
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire visant à protéger une personne en difficulté. Différente de la tutelle et de la curatelle, elle s’applique pour une courte durée et peut être mise en place suite à une déclaration médicale ou judiciaire. Mais quels en sont les mécanismes et les implications ?
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique destinée aux majeurs rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques. Contrairement à la tutelle ou à la curatelle, elle est temporaire et intervient généralement dans l’urgence pour protéger une personne particulièrement vulnérable, le temps qu’une solution plus durable soit mise en place. Elle permet ainsi d’assurer une continuité dans la protection de ses droits et intérêts.
Pour rappel, la tutelle et la curatelle sont des mesures plus contraignantes et longues, souvent mises en place après une évaluation approfondie de la situation de la personne concernée. Il ne faut donc pas confondre avec la sauvegarde de justice qui est immédiate, plus légère et transitoire.
Sauvegarde de justice médicale ou judiciaire ?
La sauvegarde de justice peut être prononcée de deux manières différentes : à la suite d’une déclaration faite par un médecin auprès du procureur de la République ou ordonnée par le juge des tutelles.
La sauvegarde de justice par déclaration médicale est définie dans l’article 434 du Code civil et l’article L3211-6 du Code de la santé publique comme une mesure de protection de courte durée. Cela arrive généralement lorsqu’une personne est hospitalisée et que son état nécessite une protection rapide de ses intérêts. Le médecin de l’établissement de santé peut ainsi initier cette démarche pour garantir une réponse rapide à cette situation d’urgence. La sauvegarde de justice judiciaire est, elle, inscrite dans les articles 425 à 439 du Code civil. Elle peut être ordonnée par le juge des tutelles à la demande d’un proche ou de toute personne intéressée. Cette démarche est souvent utilisée lorsque les difficultés de la personne concernée sont découvertes en dehors d’un contexte médical, mais nécessitant une intervention rapide. Elle répond à des causes bien spécifiques : la personne doit par exemple être dans l’impossibilité de pourvoir à ses intérêts par elle-même, en raison de l’altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles, l’empêchant d’exprimer sa volonté.
Quels droits sous sauvegarde de justice ?
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, à l’exception de ceux confiés au mandataire spécial. Cette mesure lui permet de maintenir une certaine autonomie tout en assurant la protection de ses intérêts pour les actes les plus importants. Cependant, la loi impose des limites, notamment en interdisant à la personne sous sauvegarde de justice de divorcer par consentement mutuel ou accepté, une restriction qui vise à la protéger contre des décisions prises dans un état de fragilité. Dans le prolongement de cela, le mandataire spécial, lorsqu’il est nommé, peut contester certains actes de la personne sous sauvegarde de justice qui pourraient aller à l’encontre de ses intérêts. Par exemple, lorsqu’il estime que la personne a pris une décision influencée par sa vulnérabilité. Dans ce cas, l’acte en question peut être annulé ou corrigé.
Combien de temps cette mesure peut-elle durer ?
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui n’a pas vocation à durer. C’est pourquoi elle est limitée à un an, renouvelable une fois en cas exceptionnel par le juge des contentieux de la protection. Elle ne peut donc pas dépasser deux ans. Après ce délai, une évaluation pourra déterminer si une autre mesure de protection doit être mise en place, comme la tutelle ou la curatelle.
Justine Ferrari