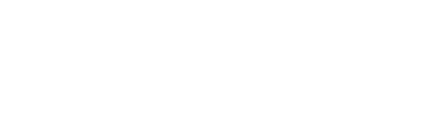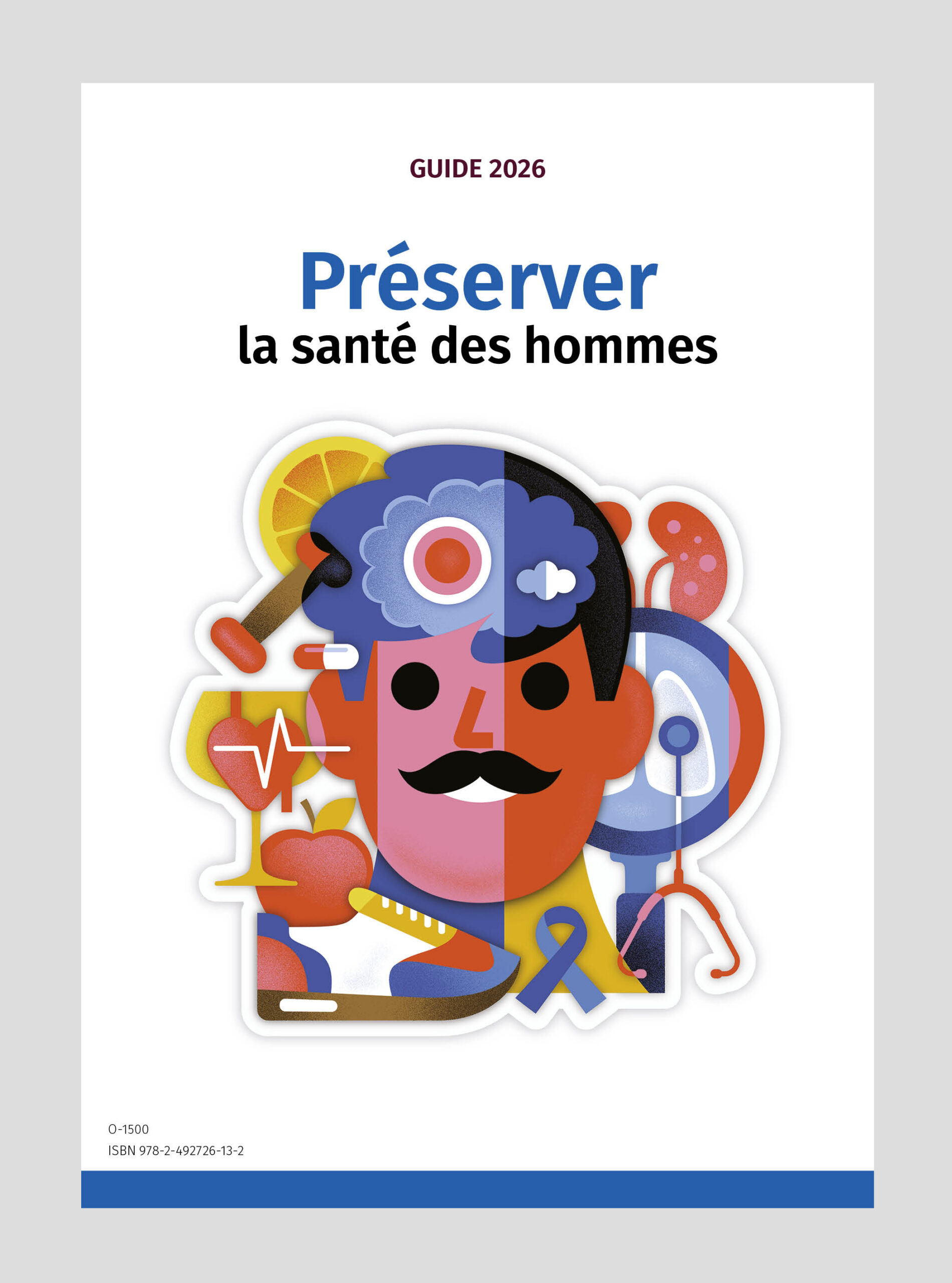Le protoxyde d’azote menace la santé des jeunes
Les intoxications liées au protoxyde d’azote, ou « proto », sont en constante augmentation. Souvent utilisé par les jeunes pour ses effets euphorisants, ce gaz hilarant peut avoir des conséquences graves sur la santé.
Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme face à la hausse inquiétante des intoxications au protoxyde d’azote. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ont toutes deux publié un communiqué le 16 avril.
Elles y révèlent que 472 signalements ont été enregistrés par les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIPA) en 2023. Cela représente une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2022. Les centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) ont quant à eux reçu 305 signalements, soit 20 % de plus qu’en 2022.
Les 18-24 ans particulièrement concernés
Le protoxyde d’azote est initialement utilisé en médecine pour ses propriétés anesthésiques. Mais il a trouvé une popularité croissante en tant que drogue récréative. Son usage détourné consiste en effet à l’inhaler par le biais d’un ballon, après avoir ouvert une cartouche de gaz. Son effet est rapide, fugace, euphorisant et permet même de ressentir des distorsions sensorielles.
Dans ce cadre, les adolescents et les jeunes adultes sont les principaux utilisateurs. Selon le Baromètre de Santé publique France, 14 % des 18-24 ans avaient déjà expérimenté ce gaz en 2022. Plus de 3 % en avaient même pris au cours de l’année. Cette consommation, souvent perçue comme inoffensive, n’est pourtant pas sans danger.
Des risques pour la santé du protoxyde d’azote
Le protoxyde d’azote peut entraîner des complications graves. C’est d’autant plus le cas quand il est consommé de manière répétée, à intervalles rapprochés et/ou à fortes doses. D’ailleurs, 92 % des signalements font état d’une consommation de doses élevées et de l’utilisation de bonbonnes de grand volume. Dans 50 % des cas, ils sont liés à une consommation quotidienne.
Le « proto » peut engendrer des troubles neurologiques tels que des engourdissements, une faiblesse musculaire, voire une perte de la capacité à marcher. Des douleurs nerveuses intenses, des troubles de la coordination et des problèmes urinaires peuvent également survenir.
Les problèmes cardiovasculaires ne sont pas en reste. La formation de caillots sanguins (thromboses) peut conduire à des embolies pulmonaires. Des symptômes psychiatriques (hallucinations, troubles de l’humeur…) ont également été observés ainsi qu’une dépendance.
Enfin, « conduire un véhicule après en avoir consommé, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un vélo ou même d’une trottinette, peut être à l’origine d’accidents graves, voire mortels », ajoute Santé publique France.
Prévenir et informer
Face à cette menace, les autorités sanitaires rappellent l’importance de la prévention. Les agences insistent sur la nécessité d’informer les jeunes des dangers du protoxyde d’azote. Fin 2023, les agences régionales de santé (ARS) des Hauts-de-France et d’Île-de-France avaient mis en place une campagne d’information (lire notre article). Une initiative qu’il serait bon de reproduire.
Les agences préconisent de mettre particulièrement en garde les femmes enceintes ou en âge de procréer. En 2023, pour la première fois, des signalements concernant des nouveau-nés présentant des troubles neurologiques à la naissance ont, en effet, été enregistrés. Ces troubles étaient liés à une consommation répétée de protoxyde d’azote par la mère pendant la grossesse.
Enfin, l’Anses et l’ANSN insistent sur le fait que la supplémentation en vitamine B12 n’est pas suffisante pour contrer les effets néfastes du protoxyde d’azote. Elle « sera systématiquement neutralisée et inefficace ». « Pour protéger sa santé, la meilleure solution est de ne pas consommer de protoxyde d’azote », concluent-elles.
Des solutions pour se faire accompagner
Pour les consommateurs et leurs proches, plusieurs ressources sont disponibles pour se faire aider. En cas d’intoxication, il est crucial de consulter un professionnel de santé ou de contacter un centre antipoison.
Pour ceux qui souhaitent arrêter leur consommation, là encore, il faut en parler à son médecin. Des structures spécialisées dans la prise en charge des addictions, comme les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), offrent un soutien adapté. Les consultations jeunes consommateurs (CJC) constituent aussi une option pour les moins de 25 ans.
De son côté, le site Drogues-info-service et son numéro gratuit, le 08 00 23 13 13, proposent également une aide précieuse.