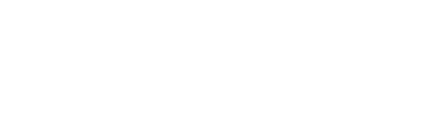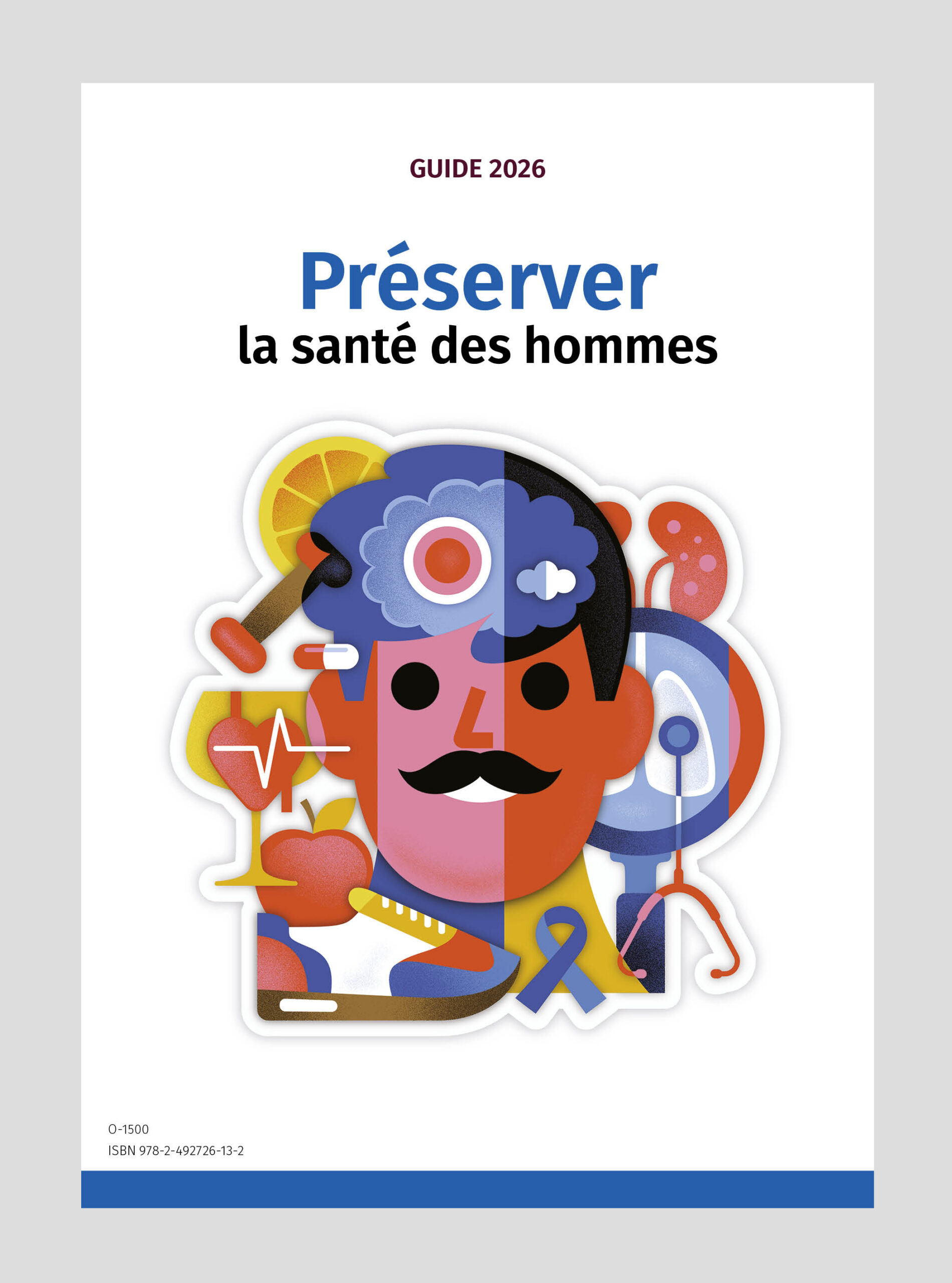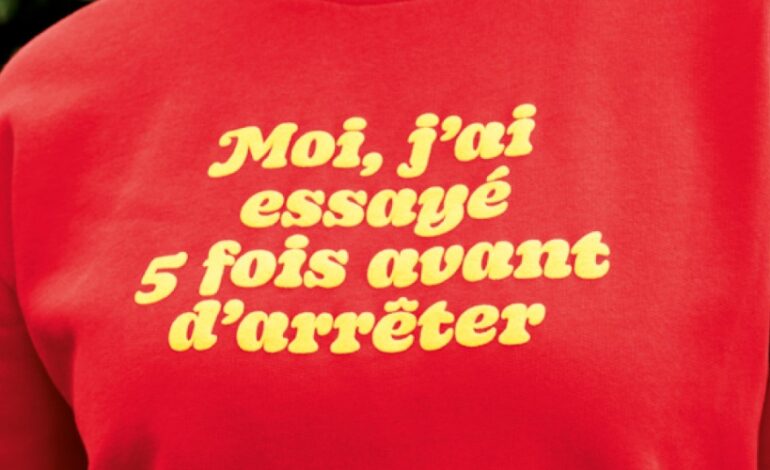Mieux accompagner la vie intime et sexuelle dans le médico-social
La Haute autorité de santé vient de publier le premier volet de ses recommandations pour changer le regard sur la vie intime et sexuelle des personnes qui vivent dans un établissement ou service social et médico-social. Un véritable enjeu de dignité et de bien-être.
La question de la vie intime, affective et sexuelle des résidents des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), est souvent passée sous silence. Pourtant, cette dimension essentielle de la dignité humaine mérite une attention particulière. La Haute autorité de santé (HAS) a donc formulé un premier volet de recommandations pour une approche positive de ce sujet. Ce document fournit des outils pour apporter aux personnes un soutien adapté, le tout dans un climat de confiance et de bienveillance. Il apporte également des repères juridiques, éthiques et organisationnels aux professionnels, mais aussi aux personnes accompagnées et à leur entourage.
La vie intime et sexuelle : un sujet encore tabou
Dans de nombreux établissements, la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de vulnérabilité reste un sujet mal abordé, voire tabou. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs de la protection de l’enfance, de l’accompagnement des personnes handicapées ou de l’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie.
Des idées reçues perdurent. Certains considèrent encore que les personnes âgées n’ont pas de sexualité ou que parler de sexualité avec les jeunes risque de les inciter à avoir des relations sexuelles. « Cette dimension pourtant cruciale de la vie humaine est souvent niée, perçue comme inexistante ou menant à des conséquences non souhaitables (grossesses inopinées, violences sexistes et sexuelles, infections sexuellement transmissibles (IST), maltraitances, etc.) », rapporte ainsi la HAS. Ce silence participe, de plus, à la frustration des personnes accueillies et nuit à leur accompagnement.
Et pourtant, ces sujets sont essentiels pour l’épanouissement personnel et le bien-être. En effet, plusieurs études soulignent les bénéfices d’une vie intime, affective et sexuelle épanouie sur la santé physique et mentale et sur la qualité de vie.
Une approche institutionnelle primordiale
Pour que cette prise en charge devienne une réalité, la HAS préconise une approche institutionnelle forte. La prise en compte de la vie intime, affective et sexuelle doit impérativement être inscrite dans les valeurs de l’établissement, et ce dès les premières étapes de l’accueil des résidents. Cela passe par une réflexion globale qui doit apparaître dans les projets d’établissement ou de service, mais aussi dans les documents administratifs comme le règlement de fonctionnement ou le livret d’accueil.
Former les équipes médico-sociales
Un changement de culture au sein de ces établissements doit également inclure la formation des équipes. Cela permet de sensibiliser l’ensemble des professionnels à l’importance de ces questions et de leur donner les outils nécessaires pour les aborder sereinement. La HAS recommande notamment de désigner un référent spécialisé dans la vie intime, affective et sexuelle. Elle préconise aussi de mettre en place de temps d’échange entre les professionnels pour discuter de ces enjeux.
Respecter les aspirations de chacun
Une autre dimension primordiale est le respect des aspirations individuelles des personnes accueillies. Il est effectivement important de comprendre que certaines personnes n’ont pas de désir d’accompagnement dans ce domaine, tandis que d’autres peuvent en exprimer le besoin. Il faut donc respecter les rythmes et les limites de chaque individu afin d’éviter toute souffrance ou maltraitance.
Dans ce cadre, l’accès à des informations claires, adaptées et non infantilisantes est fondamental. L’éducation à la vie intime, affective et sexuelle, par exemple, est nécessaire pour les jeunes résidents (lire aussi notre article). Elle permet de prévenir des situations de violences sexistes et sexuelles. Elle sensibilise aussi au consentement et à l’autodétermination. Mais cette approche positive reste bénéfique à tout âge, notamment pour prévenir les violences et gérer les relations interpersonnelles au sein de l’établissement.
Un second volet de recommandations, prévu pour l’année prochaine, détaillera davantage les outils et pratiques à mettre en place pour une prise en charge encore plus fine et adaptée.
© CIEM / Constance Périn