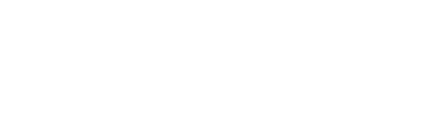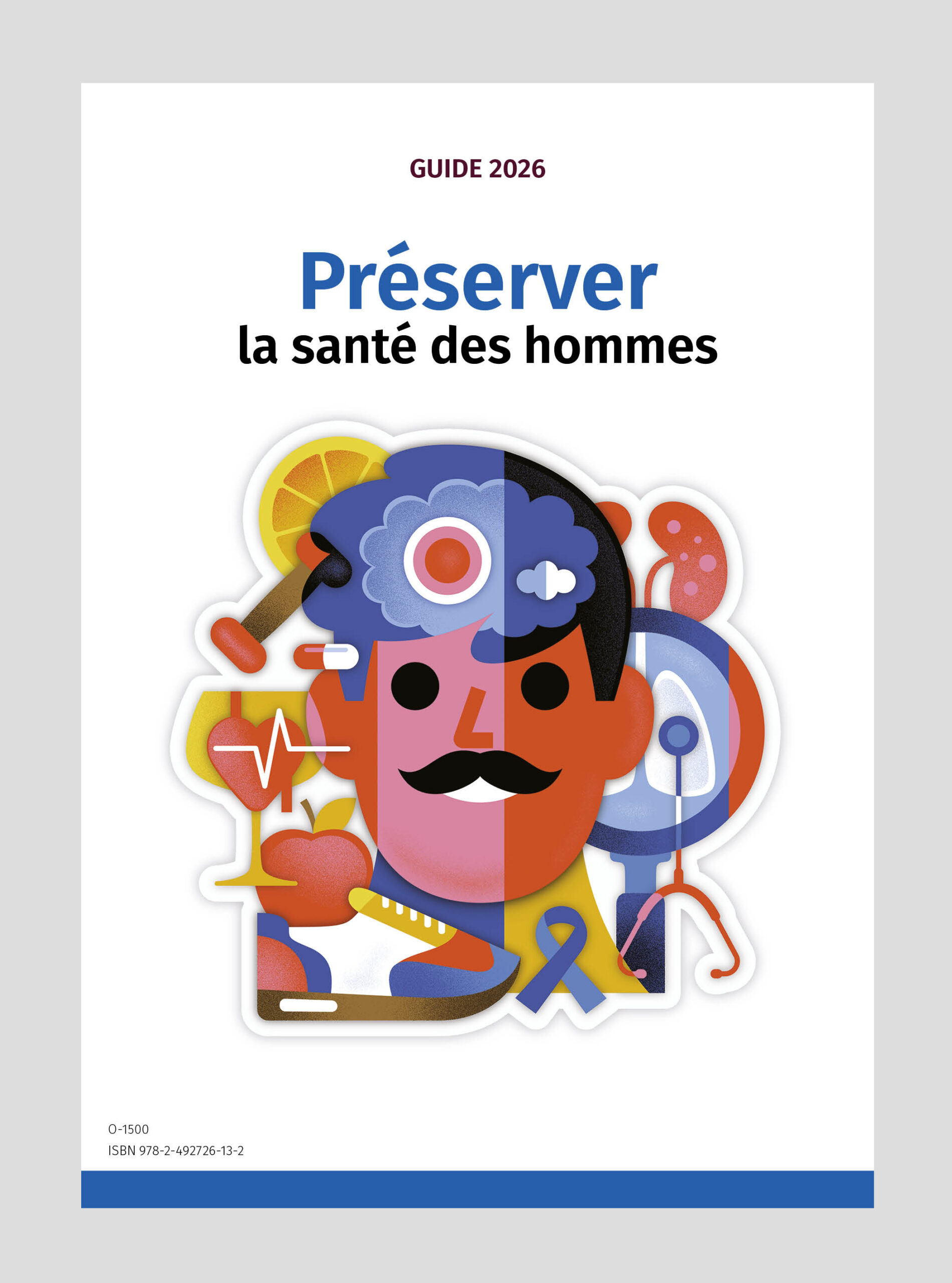Lutte contre les déserts médicaux : le plan du gouvernement
Le Premier ministre, François Bayrou, a dévoilé son plan pour combattre les déserts médicaux. Il prévoit des mesures concrètes pour améliorer l’accès aux soins pour des millions de Français. On fait le point.
C’est à l’occasion d’un déplacement dans le Cantal, vendredi 25 avril, que François Bayrou a présenté le plan d’action du gouvernement pour renforcer l’accès aux soins des Français. En 2024, six millions de personnes n’avaient en effet pas de médecin traitant. De plus, 87 % du territoire était classé en désert médical. Le Premier ministre a déploré « le parcours d’obstacle qu’est pour des millions de Français l’accès aux soins malgré les efforts déjà entrepris ».
Cartographier les déserts médicaux
La première étape du plan consiste à cartographier précisément les déserts médicaux. Les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les préfets et les élus locaux, en sont chargées. Elles devront d’ici la fin du mois de mai identifier des « zones rouges » à l’échelle de l’intercommunalité. Ces zones, où l’accès aux soins est particulièrement dégradé, feront l’objet d’une attention prioritaire des pouvoirs publics. L’objectif est d’y améliorer rapidement la situation.
Former plus et mieux
L’un des axes majeurs du plan est la formation. Dès la rentrée 2026, l’accès aux études de santé sera élargi et disponible dans chaque département. Cela se fera grâce à la généralisation des antennes de formation, des campus connectés, et d’autres solutions locales. Plus de 3 700 internes de 4e année de médecine générale exerceront sur l’ensemble du territoire. Ils seront aussi fortement incités à pratiquer en zones sous-denses. Par ailleurs, 100 % des étudiants en médecine devront réaliser au moins un stage en dehors des centres hospitaliers universitaires (CHU) et un en zone sous-dense, durant leur cursus.
Instaurer un principe de solidarité
Françoise Bayrou a aussi annoncé la création d’un principe de solidarité territoriale. Chaque médecin devra donc consacrer jusqu’à deux jours par mois à des consultations dans les zones rouges. Cette mobilisation se fera par concertation locale et en fonction des besoins. Le tout « dans une logique pragmatique mais dans une logique d’exigence de résultats », précise le gouvernement.
Réduire les formalités administratives
Pour permettre aux médecins de se concentrer davantage sur leurs patients, le plan prévoit de réduire le temps consacré aux formalités administratives. Ainsi, « les certificats médicaux ne reposant sur aucun fondement juridique ou médical seront supprimés ». Les activités « secondaires » seront encadrées et plafonnées. C’est le cas notamment de la médecine esthétique pratiquée par des généralistes.
De nouvelles coopérations professionnelles seront également déployées. Le rôle des infirmiers de pratique avancée sera ainsi renforcé (lire notre article sur la démographie du métier).
Soutenir les initiatives locales
Le plan met par ailleurs en avant les efforts des élus locaux. Le but est « de créer, avec eux, des conditions d’accueil toujours plus attractives » pour les professionnels de santé et les étudiants. Cela inclut le développement des internats ruraux, le logement des étudiants, la création de crèches…
La combinaison de toutes ces mesures pourrait permettre 50 millions de consultations supplémentaires par an dans les zones sous-dotées, estime le gouvernement.
De nombreuses réactions
Les annonces de François Bayrou ont fait réagir. L’Association des petites villes de France (APVF) par exemple « salue une prise de conscience salutaire, mais souligne que l’urgence impose des mesures plus structurelles et plus courageuses ».
Les professionnels de santé ont également fait entendre leur voix. Pour la Fédération nationale des infirmiers (FNI), « ce plan constitue un retour en arrière, puisqu’il restaure la hiérarchie entre les médecins et les professions paramédicales pourtant enterrée avec le XXe siècle ».
Le Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants en France (Reagjir) estime que « ce plan d’action ouvre des possibilités qu’il convient de préciser afin de transformer l’essai et d’améliorer l’accès aux soins ». Mais il regrette la poursuite de l’examen de la proposition de loi Garot. Celle-ci vise à réguler l’installation des médecins. L’un de ses articles phares avait été adopté début avril par l’Assemblée nationale, ce qui avait provoqué la colère de la profession. Les syndicats ont donc maintenu leur appel à la grève qui a débuté le 28 avril.
Pour être mis en œuvre, le plan du Premier ministre devra être traduit en textes réglementaires et législatifs qui seront soumis au Parlement. Plusieurs projets et propositions de loi sont déjà programmés pour les prochaines semaines.