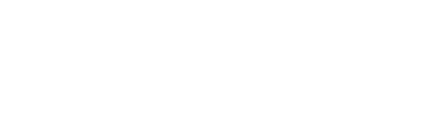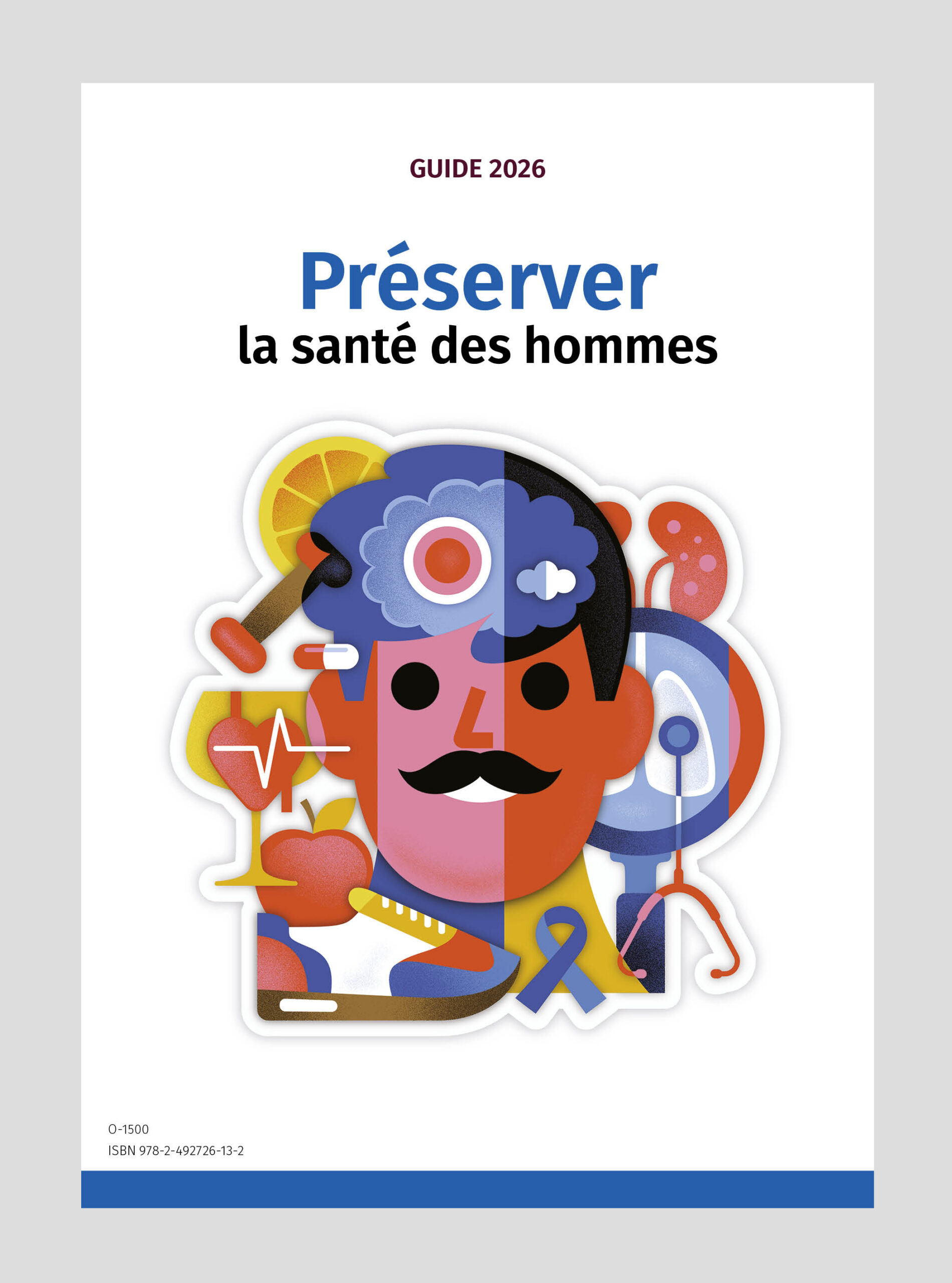Maladie d’Alzheimer : où en est-on aujourd’hui ?
La maladie d’Alzheimer affecte progressivement la mémoire, le raisonnement, l’orientation ou encore la prise de décision jusqu’à la perte d’autonomie de la personne. Si d’énormes progrès dans la compréhension de ses mécanismes ont été réalisés ces dernières années, les recherches se poursuivent pour espérer, un jour, pouvoir guérir les malades.
Dossier rédigé par Léa Vandeputte
La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative complexe. Elle touche 40 millions de personnes dans le monde et plus d’un million de Français. Et ces chiffres devraient augmenter dans les années à venir. En cause : la hausse de l’espérance de vie car la prévalence de la maladie d’Alzheimer s’accroît avec l’âge. On estime ainsi à 150 millions le nombre de malades dans le monde en 2050. D’où l’importance de la recherche sur cette pathologie.
Du trouble de la mémoire à la dépendance
L’évolution de la maladie d’Alzheimer diffère selon les patients. Ils font face à des troubles de la mémoire – symptôme le plus connu et le plus fréquent – mais pas seulement. Leurs fonctions exécutives, qui permettent de mener une succession d’actions pour atteindre un objectif, peuvent aussi en être affectées. Il devient, par exemple, difficile de réaliser les différentes étapes d’une recette pour obtenir un plat que l’on affectionne particulièrement. Les malades peuvent également éprouver des difficultés à se repérer dans le temps et dans l’espace, ou encore voir apparaître des troubles du langage et de l’humeur. Progressivement, leur autonomie se réduit et provoque une dépendance, qui n’est pas sans conséquences sur le quotidien de la personne et de son entourage.
Des lésions cérébrales identifiées
Mais que se passe-t-il exactement au niveau du cerveau ? « On observe deux types de lésions : les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires, explique le Dr Jean-Charles Lambert, directeur de recherche de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), au laboratoire Facteurs de risque et déterminants moléculaires des maladies liées au vieillissement (Inserm, institut Pasteur de Lille, université de Lille, centre hospitalier universitaire de Lille). Les premières sont associées aux peptides ß‑amyloïde, qui sont naturellement présents dans le cerveau mais qui, dans le cas de la maladie d’Alzheimer, s’accumule jusqu’à former des dépôts, des plaques, qui empêchent les connexions entre les neurones. Les secondes sont liées à la protéine Tau qui, modifiée, désorganise la structure des neurones, produisant ainsi une dégénérescence. » Petit à petit, ces anomalies affectent l’ensemble du cerveau à partir de l’hippocampe, le siège de la mémoire à court terme, et détruisent les neurones.
Entre facteurs environnementaux et génétiques
Le principal facteur de risque reste l’âge, la maladie d’Alzheimer touchant de 2 à 4 % de la population après 65 ans. Elle atteint plus de 15 % des personnes après 80 ans. L’environnement joue également un rôle. Les pathologies cardiovasculaires, comme le diabète, l’hypertension ou l’hypercholestérolémie, quand elles ne sont pas prises en charge, sont associées à un risque accru. C’est aussi le cas de la sédentarité. Enfin, les traumatismes crâniens, qui surviennent notamment chez les sportifs, ou encore les anesthésies répétées auraient un impact.
La maladie possède par ailleurs une composante génétique. « Dans des formes héréditaires rares, qui représentent moins de 1 % des cas, des mutations au niveau de trois gènes ont été identifiées, indique le directeur de recherche. Celles-ci provoquent systématiquement l’apparition d’une forme précoce de la maladie, souvent avant 50 ans. »
Dans les formes plus communes, plusieurs gènes modulent le risque d’être malade. L’équipe du Dr Lambert a d’ailleurs publié, au mois de juin dans la revue Nature Genetics, les résultats d’une étude qui a évalué les associations entre les scores de risque génétique et la survenue de la maladie dʼAlzheimer dans différentes populations du monde (d’Australie, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Europe). « Pour les formes communes de la maladie, il existerait deux entités génétiques distinctes : l’une dépend principalement d’un facteur de risque génétique appelé Apolipoprotéine E (APOE) et l’autre d’une combinaison de nombreux facteurs de risque génétique, indique le chercheur. De façon surprenante, cette dernière entité est assez similaire entre les différentes populations à travers le monde alors que l’impact de lʼAPOE diffère entre ces différentes populations. Ainsi, le gène de lʼAPOE porterait une grande partie de la variabilité génétique relative au risque de développer la maladie dʼAlzheimer entre ces populations. » Cette découverte permet d’améliorer la compréhension des mécanismes impliqués.
Vers un diagnostic par prise de sang
Dès l’apparition des premiers signes de la maladie d’Alzheimer, il est important de poser un diagnostic afin de mettre en place une prise en charge adaptée. Le médecin traitant est souvent le professionnel de santé de premier recours. C’est lui qui va orienter le patient vers une « consultation mémoire », menée par un gériatre, un psychiatre ou un neurologue. Plusieurs examens sont alors réalisés : bilan neuropsychologique, imagerie (IRM, scanner), bilan sanguin, ponction lombaire… C’est l’ensemble des résultats qui permettront de confirmer ou non le diagnostic. « Mais tout cela peut prendre du temps, constate Benoît Durand, directeur délégué de l’Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées. Dans certaines régions, avoir un rendez-vous avec un spécialiste peut s’avérer compliqué. Il existe de fortes inégalités territoriales d’accès au diagnostic. On estime que 30 à 40 % des malades ne sont pas diagnostiqués en France ; un problème d’accès aux centres experts pouvant l’expliquer en partie », regrette Jean-Charles Lambert.À ces difficultés, s’additionnent celles du coût des tests et leur aspect invasif. Toutefois, la situation pourrait bien évoluer rapidement. « Les États-Unis viennent d’autoriser un test sanguin, qui dose la concentration des protéines peptides ß‑amyloïde et Tau, les deux marqueurs de la maladie d’Alzheimer, explique Kévin Rabiant, responsable du service Études et recherche chez France Alzheimer. Il permet de poser un diagnostic fiable et rapide chez les personnes qui présentent des symptômes. » Une demande de mise sur le marché a été déposée auprès des autorités européennes qui doivent rendre leur décision à l’automne.
Traitements : la piste de l’immunothérapie
Du côté de la prise en charge médicamenteuse, les possibilités sont pour le moment limitées. « À ce jour, il n’existe pas de traitement qui permette de guérir la maladie d’Alzheimer », confirme Kévin Rabiant. Quatre médicaments (donépézil, galantamine, rivastigmine et mémantine) peuvent être prescrits pour réduire les symptômes. Cependant, ils ont été déremboursés en 2018 par l’Assurance maladie, du fait de leur faible efficacité et de leur mauvaise tolérance. Des arguments contestés par les associations comme France Alzheimer qui rappelle que seuls trois pays européens ne les prennent plus en charge : l’Albanie, la Lettonie et la France. « C’est un mauvais message qui a été envoyé aux médecins généralistes qui ne prescrivent plus ces médicaments, estime Kévin Rabiant. Et s’ils le font tout de même, le déremboursement augmente le reste à charge des patients. »
Depuis mi-avril, un nouveau traitement – le lecanemab – a été autorisé en Europe. Il est en cours d’évaluation en France. « Il s’agit d’une immunothérapie qui s’attaque aux peptides ß‑amyloïdes, ce qui permet de ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer sans pour autant la stopper, précise le Dr Lambert. L’inconvénient est qu’il peut provoquer des effets secondaires importants (des hémorragies cérébrales). Pour limiter le risque, il faut donc suivre les malades par imagerie. » Ce médicament, administré par perfusion toutes les deux semaines, ne s’adresse qu’à certains patients en début de pathologie, avec des symptômes légers. « En France, seuls 7 % des malades seraient éligibles », ajoute Jean-Charles Lambert. Il est de plus coûteux : autour de 26 000 dollars par an aux États-Unis. Malgré ces freins, ce nouveau médicament constitue une avancée et permet de gagner du temps face à l’évolution de la maladie d’Alzheimer.
Le 25 juillet, l’Agence européenne des médicaments a rendu un avis positif à la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau médicament. Il s’agit d’un « anticorps monoclonal dirigé vers les plaques de protéine bêta-amyloïde visant à nettoyer
le cerveau de leur accumulation », explique France Alzheimer. Mais celui-ci peut être responsable d’effets secondaires et seul un faible nombre de malades devraient pouvoir en bénéficier.
Maintenir l’autonomie et le bien-être
Au-delà des traitements médicamenteux, la prise en charge doit être multidimensionnelle afin d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Les différents accompagnements ont pour objectif commun de maintenir les aptitudes physiques et psychiques pour préserver autant que possible l’autonomie et le bien-être. Elles peuvent faire intervenir différents professionnels : infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste, audioprothésiste, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, auxiliaire de vie…
L’hygiène de vie est de plus déterminante. Ainsi, le maintien d’une activité physique adaptée et régulière participe à la préservation de l’autonomie et d’un équilibre au niveau corporel et mental. Tout comme une alimentation équilibrée et variée aide à conserver ses capacités et prévient le risque de dénutrition.
De plus, une attention toute particulière est portée aux aptitudes sensorielles et notamment à la vue et à l’audition. La baisse de la vision et la surdité aggravent en effet les troubles de la mémoire, car elles gênent la communication et restreignent la vie sociale. S’appareiller fait donc partie intégrante d’une bonne prise en charge.
Enfin, les associations de familles concernées par la maladie proposent par exemple des ateliers et animations, ou encore des formations et des groupes de parole à destination des aidants.
Quoi qu’il en soit, les différentes interventions doivent être adaptées en fonction des envies et des habitudes de vue de la personne. Une prise en charge n’est de qualité que si elle est acceptée, sans contrainte et avec plaisir.
L’impact de la maladie sur les aidants
Face à la perte d’autonomie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les aidants sont en première ligne. Ce sont eux qui gèrent le quotidien, font le lien avec les professionnels de santé, tiennent compagnie, etc. Mais, très sollicités, les aidants, qui sont souvent les conjoints des malades, s’épuisent au point que leur espérance de vie est divisée par deux par rapport aux personnes de même âge. D’où l’importance de prendre en compte leurs besoins et de leur apporter un soutien adapté et personnalisé.
Les maladies apparentées à Alzheimer : de quoi s’agit-il ?
Une dizaine de pathologies sont dites apparentées à la maladie d’Alzheimer. Elles présentent des similitudes, au niveau des symptômes, mais également des différences du fait de leurs mécanismes et de leur prise en charge. Citons, par exemple, la maladie à corps de Lewy, maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer, la dégénérescence lobaire frontotemporale (DLFT, qui affecte le lobe frontal) ou le syndrome de l’aphasie primaire progressive (qui touche le langage).
La recherche continue
La recherche sur les différents aspects de la maladie d’Alzheimer se poursuit malgré des difficultés de financement en France et en Europe. Les scientifiques s’intéressent particulièrement aux facteurs génétiques de la maladie. L’équipe du docteur Jean-Charles Lambert, du laboratoire « Facteurs de risque et déterminants moléculaires des maladies liées au vieillissement » (l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, institut Pasteur de Lille, université de Lille, centre hospitalier universitaire de Lille), en a ainsi déterminé 90 et cherche maintenant à connaître plus précisément leurs impacts. La compréhension des mécanismes moléculaires qui conduisent au développement de la maladie mobilise également, notamment pour essayer d’empêcher la formation des lésions cérébrales. Autant de pistes de recherches qui, sans doute, auront des impacts importants sur le quotidien des malades et de leurs proches dans les années à venir.
Pour aller plus loin
À lire. La bande dessinée Plongée au cœur d’Alzheimer, consultable gratuitement sur le site de l’Inserm :
www.inserm.fr/culture-scientifique/plongee-coeur-alzheimer/
À regarder. Les témoignages d’anonymes et
de célébrités (Sami Bouajila, Didier Morville, Alain Chamfort, Thierry Frémont, Loïck Peyron) réalisés par l’association France Alzheimer et maladies apparentées sur sa chaîne YouTube, puis « Territoire de l’intime ».
À écouter. Podc’Alz, le podcast de la fondation Recherche Alzheimer, sur Apple podcast, Spotify, Deezer, Amazon music et Podcast Addict.