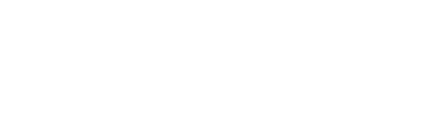Mathias Wargon : « Notre système hospitalier est à bout, il faut le réformer »
Connu pour son franc-parler, Mathias Wargon, médecin urgentiste, raconte dans son livre Hôpital : un chef-d’oeuvre en péril*, son quotidien et les bouleversements liés à la crise sanitaire et à l’après. Il partage ainsi sa vision de l’hôpital, de ses dysfonctionnements et de ses difficultés. Loin d’être pessimiste, il propose également des pistes de réflexion pour le réformer et pour lui permettre de retrouver sa juste place au sein de notre système de santé.
Mathias Wargon dirige les urgences et le service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis (93). Docteur en sciences, il est aussi président de l’Observatoire régional des soins non programmés d’Île-de-France.
La crise de la Covid-19 a été un énième révélateur de la situation difficile de l’hôpital. Qu’est-ce que cela a changé ?
Mathias Wargon. Sur le moment, elle a permis à l’hôpital de se resserrer autour de ses missions et de redonner du sens. Mais, directement après la première vague, l’hôpital est retombé dans ses mauvaises habitudes. Finalement, la crise n’a fait qu’accélérer sa destruction. Avant la Covid, des collectifs s’étaient déjà créés, comme le Collectif interhôpitaux ou le Collectif interurgences, qui ont posé les questions que tout le monde avaient en tête, même s’ils n’ont pas forcément apporté les bonnes réponses. Puis, la Covid est arrivée, et tout ce qui ne fonctionnait pas avant n’allait pas marcher après. Nous avons été confrontés à une fuite des personnels, qui n’a d’ailleurs pas concerné que l’hôpital, mais le monde du travail en général, et même en dehors de la France. L’hôpital était déjà très fragile. Les soignants se sont, d’une certaine manière, détachés de leur travail et ont multiplié les demandes, notamment sur les changements d’horaires.
Ressentez-vous le manque de reconnaissance de la population envers les soignants ?
M. W. Pendant le premier confinement, la question de la reconnaissance a été particulièrement discutée. Au fil de la crise, certains ont remis en cause la parole des soignants allant même jusqu’à les traiter d’assassins. Même si cela concerne seulement une minorité de personnes, cela a tout de même eu un impact. Quant à la crise de sens des soignants, elle existait déjà avant. La Covid en elle-même a redonné un sens, puis nous sommes revenus à l’état antérieur. Travailler à l’hôpital, cela a du sens, évidemment, mais est-ce que les conditions de travail sont suffisantes pour le conserver ? Les conditions sont en effet moins bonnes à l’hôpital que dans n’importe quelle entreprise, tant au niveau du respect des personnels que de la gestion du temps, de la paye ou encore de l’environnement de travail, qui est très mauvais.
De nouvelles difficultés ont-elles émergé au niveau des services des urgences ?
M. W. Les difficultés se sont plutôt aggravées. Là où, il y a deux ou trois ans, nous avions des problèmes de recrutement de médecins, aujourd’hui nous avons toujours ces mêmes problèmes, mais en plus nous avons des soucis pour trouver des infirmières ou des aides-soignantes. Nous commençons à avoir des services d’urgences qui ferment la nuit, qui délestent – c’est-à-dire qui renvoient tous les patients régulés vers d’autres services d’urgences. Cette situation, que nous avons hélas l’habitude de voir en plein été, est maintenant courante à des périodes où normalement les services fonctionnent. Les problèmes en aval, de lits d’hospitalisation, ont aussi augmenté. La Covid nécessite en effet d’isoler les patients. Or, nous avons une carence de chambres où la personne est seule. Cette situation a complexifié l’organisation de l’hôpital.
Quelles seraient alors les solutions ?
M. W. Il y a plusieurs problèmes à résoudre. Pourquoi toutes ces personnes vont-elles aux urgences ? Elles viennent parce qu’il n’y a plus d’offre de soins en ville, parce qu’elle ne correspond pas à leurs horaires ou qu’elle n’est pas adaptée. Il y a aussi un certain consumérisme médical. Il faut d’ailleurs peut-être réhabituer les gens à se traiter en partie seuls. Il faut aussi probablement élargir l’offre de soins. Nous avons des infirmières, des pharmaciens ou des kinés, par exemple, qui prendraient très bien en charge certaines pathologies. Mais nous voyons bien que les médecins sont très ambigus sur cette question : ils disent à la fois qu’ils ne peuvent pas tout faire, mais, dès que l’on parle d’ouvrir vers d’autres professions, ils crient à l’ubérisation. Il faut aussi résoudre l’aval, c’est-à-dire les lits d’hospitalisation, mais aussi ce que l’on appelle « l’aval de l’aval », comme les soins de suite après l’hospitalisation. Parfois, les lits ne manquent pas tant à l’hôpital que dans les établissements qui prennent la suite. Certains patients deviennent des bed blockers, des bloqueurs de lits, pendant des jours, des mois, voire des années parfois, parce que nous n’avons pas de solution à leur proposer. Et pour finir, il y a le problème des urgences, qui font face à la fuite des personnels. Il faut probablement améliorer les rémunérations, mais aussi et surtout les conditions et les temps de travail.
« Il faut ouvrir une partie du travail des médecins aux autres professionnels de santé. »
M. Dans votre livre, vous expliquez qu’il faudrait s’appuyer sur d’autres professionnels de santé. Comment ?
M. W. Il faut ouvrir une partie de notre travail aux autres professionnels de santé. Un kiné, par exemple, saura mieux prendre en charge une entorse que moi. Évidemment, il faut que cette évolution ne se fasse pas de façon désorganisée. Il faut qu’elle soit soumise à des diplômes, à des évaluations. Il existe déjà les infirmières de pratique avancée qui ont plus de prérogatives, mais il faut aller plus loin. Nous sommes un des rares pays où l’on ne permet pas à nos infirmières d’évoluer, ni sur le plan du métier, ni sur le plan universitaire. Il existe par exemple aux États-Unis les nurses practitioners : ce sont des infirmières qui ont de l’expérience, qui sont diplômées, qui ont une autonomie de prescription, et qui voient des patients seules même aux urgences. Cela n’existe pas en France, et je ne comprends pas pourquoi nous ne nous en inspirons pas mis à part par corporatisme, par conservatisme, etc.
Le développement de la téléconsultation constitue-t-il une piste ?
M. W. Nous avons vu l’explosion de la téléconsultation pendant la Covid et c’est une bonne solution pour effectuer un suivi. Je ne suis pas certain qu’elle convienne pour une première consultation. Il existe aussi des expériences de téléconsultation en présence d’un infirmier, cela peut être intéressant. Le médecin doit examiner le patient, recueillir les informations, mais tout cela il peut le faire pendant la téléconsultation, aidé par un autre professionnel de santé sur place. Finalement, cela lui permet de gagner du temps, car il ne se déplace pas. Ce n’est pas de la science-fiction, car techniquement nous pouvons le faire. Reste à savoir comment le financer et le développer.
Vous évoquez aussi la sous-médicalisation des Ehpad, qui a des conséquences pour l’hôpital.
M. W. Le livre sur les Ehpad qui vient de sortir [Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, éditions Fayard – NDLR] n’a pas été une surprise pour les urgentistes. Nous recevons à l’hôpital des patients qui viennent uniquement parce qu’ils ont besoin d’un avis médical et qu’ils n’ont pas pu voir leur médecin. Nous savons aussi qu’il n’y a pas d’infirmières la nuit dans les Ehpad et qu’il n’y a que des aides-soignants qui ont la charge d’un grand nombre de personnes : c’est un drame. Là encore, la téléconsultation pourrait apporter un plus, pour donner un avis par exemple.
Le Ségur de la santé a permis des avancées notamment en termes de rémunérations. Faut-il aller plus loin ?
M. W. Je pense que notre système hospitalier est à bout, il faut le réformer sur le plan du financement, mais surtout sur celui de l’organisation. Nous avons un hospitalocentrisme très important en France, à la fois parce que les hospitaliers pensent qu’ils savent tout faire et à la fois parce que, dès que le système de santé n’a pas envie de faire quelque chose ou ne peut pas le faire, il se retourne vers l’hôpital. À un moment, il faudra faire en sorte que les tâches effectuées à l’hôpital pour un coût extrêmement élevé puissent être effectuées par la médecine de ville pour un coût plus modéré et, probablement, avec une meilleure qualité.
Propos recueillis par Léa Vandeputte / © C i E M
*Hôpital : un chef-d’œuvre en péril, de Mathias Wargon avec la collaboration de Jean-Marie Godard, Fayard, 180 pages.