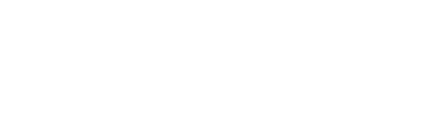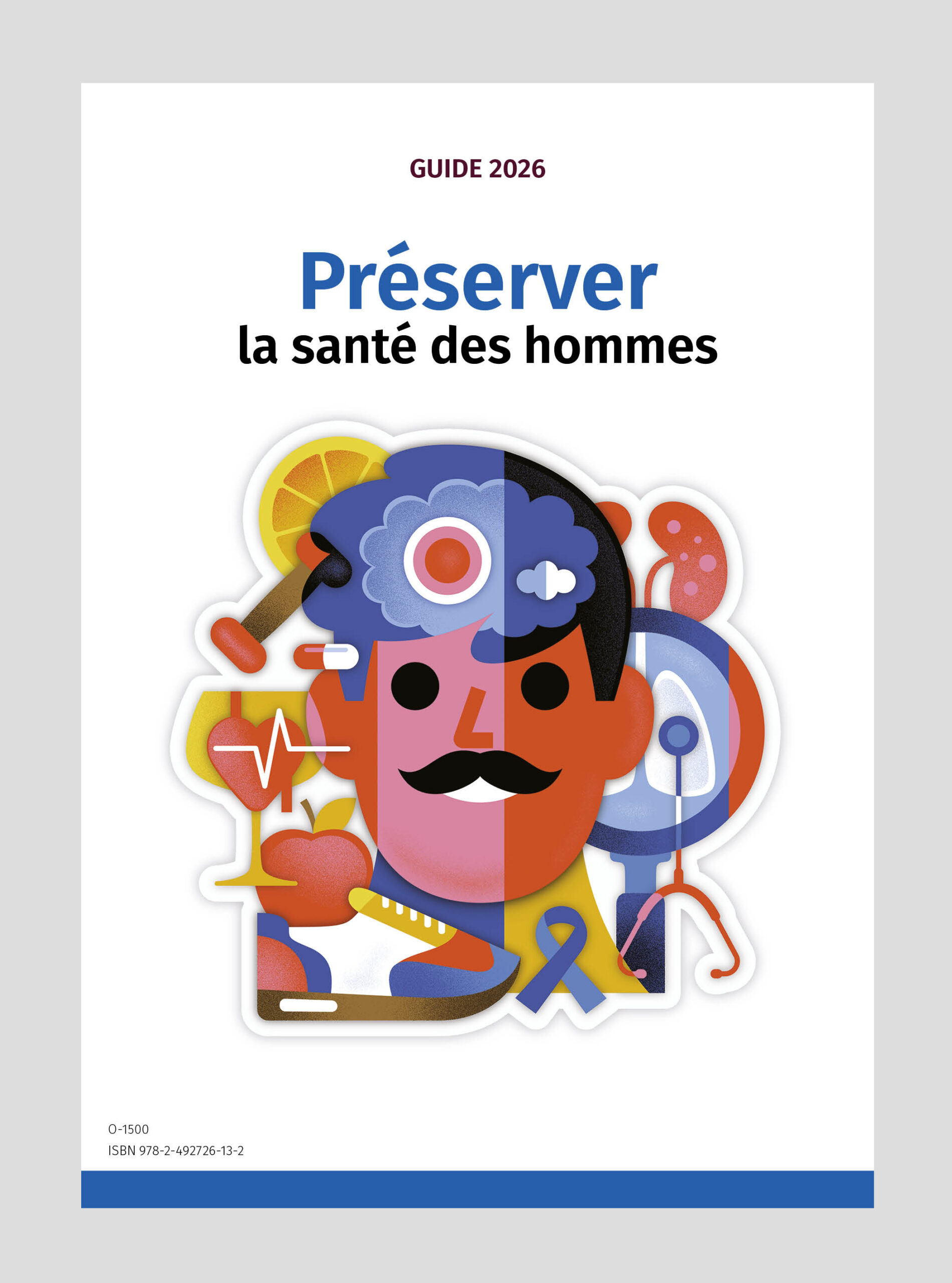Pfas : mieux surveiller les polluants éternels
L’Agence nationale de sécurité sanitaire publie un état des lieux inédit de la pollution liée aux composés per et polyfluoroalkylées (Pfas). Elle recommande aussi d’élargir leur surveillance pour mieux protéger la population.
Quelle est l’ampleur de la contamination par les Pfas, aussi appelés « polluants éternels », en France ? C’est à cette question qu’a voulu répondre l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Elle a publié, le 22 octobre, un avis et deux rapports assortis de recommandations. Elle y propose notamment des stratégies pour identifier, contrôler et réduire l’impact de ces substances.
Des composés persistants et toxiques
Les Pfas forment une famille de plusieurs milliers de composés chimiques. Ces derniers sont utilisés depuis les années 1950 pour leurs propriétés antiadhésives, imperméables et résistantes à la chaleur. On les retrouve ainsi dans les poêles antiadhésives, les textiles imperméables, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les mousses anti-incendie, etc.
S’ils sont très pratiques pour l’industrie, ils présentent néanmoins la particularité de persister très longtemps dans l’environnement (eau, air, sol…) et dans les organismes. Problème : ces substances sont toxiques. Leurs effets cancérigènes, perturbateurs endocriniens ou reprotoxiques sont de plus en plus documentés.
Encore peu de suivi des Pfas
À l’heure actuelle, seuls quatre Pfas font l’objet d’une réglementation pour certains aliments (œufs, viandes, poissons) en France. Vingt autres figurent dans la directive européenne sur l’eau potable. Mais la surveillance de ces derniers ne deviendra obligatoire qu’à partir de 2026. Peu de Pfas sont donc répertoriés et analysés. Les études sur leur présence dans l’environnement ne sont, de plus, pas assez nombreuses.
Des informations de contamination hétérogènes
Pour combler ce vide, l’Anses a mené une enquête d’ampleur inédite. Entre septembre 2023 et septembre 2024, elle a compilé près de deux millions de données concernant 142 Pfas, issues de multiples sources (eaux potables, sols, poussières, aliments, cosmétiques, sang, lait maternel…). Toutefois, l’agence souligne « l’hétérogénéité du nombre de données disponibles selon les compartiments et les substances ». Ainsi, les eaux et les aliments sont relativement bien documentés. En revanche, l’air, les poussières et les sols restent des angles morts.
Et quand les données françaises n’étaient pas disponibles, l’Anses a intégré des résultats d’études européennes. Une approche rendue possible par l’absence de frontières pour ces polluants.
Finalement, ces travaux ont permis de déterminer que les niveaux moyens de Pfas dans le sang des Français, bien que détectables, restent inférieurs aux rares seuils sanitaires existants. Cette situation est d’ailleurs comparable à celle des autres pays européens. « Concernant les expositions professionnelles, aucune donnée française n’a été identifiée », note tout de même l’agence.
Vers une surveillance ciblée
Pour améliorer les connaissances, l’Anses préconise de surveiller plus particulièrement les Pfas les plus toxiques. C’est le cas notamment de l’acide trifluoroacétique (TFA), présent dans l’eau et très répandu.
En parallèle, l’agence a développé une méthode de catégorisation des Pfas. Celle-ci comporte trois parties. La première concerne la surveillance pérenne, « pour les substances les plus préoccupantes et récurrentes dans le cadre des plans de surveillance nationaux ». La deuxième est la surveillance exploratoire, réalisée ponctuellement, « pour les substances pas ou insuffisamment recherchées aujourd’hui ». Enfin la troisième s’intéresse à la surveillance localisée, « pour des substances correspondant à des sources de contaminations locales avérées ou suspectées, que les contaminations soient anciennes ou actuelles ».
Grâce à cette approche, elle a pu intégrer 247 Pfas à sa stratégie de surveillance.
Agir à la source pour limiter les Pfas
Pour aller plus loin, l’agence recommande d’orienter la collecte de données supplémentaires et la recherche sur ces substances. Elle souhaite aussi actualiser la surveillance des Pfas au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles données de contamination et de toxicité. Elle préconise également mettre en place un dispositif national pour actualiser régulièrement la catégorisation qu’elle a proposée.
De plus, elle rappelle qu’il est impératif d’agir à la source pour éviter les émissions de Pfas. Une restriction européenne, en cours d’instruction par l’Agence européenne des produits chimiques (Echa), vise justement à limiter leur utilisation.
Enfin, l’Agence plaide pour une approche globale. Elle estime que la surveillance doit concerner tous les polluants (lire aussi notre article) : Pfas, dioxines, polychlorobiphényle (PCB), métaux lourds…
Autant de substances qui ne disparaîtront pas demain, mais dont l’impact, lui, peut être atténué rapidement, à condition d’agir sans délai.