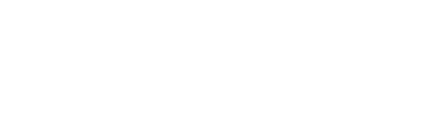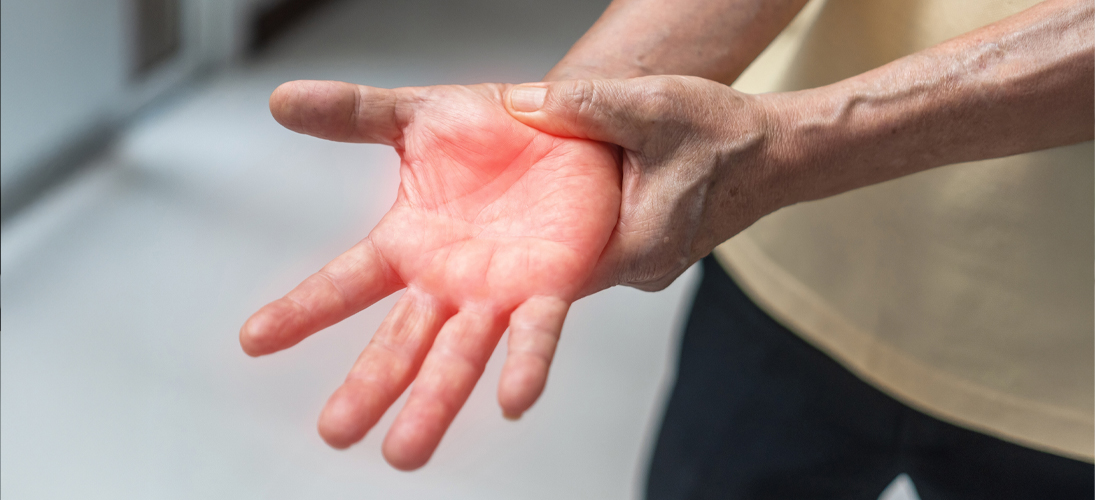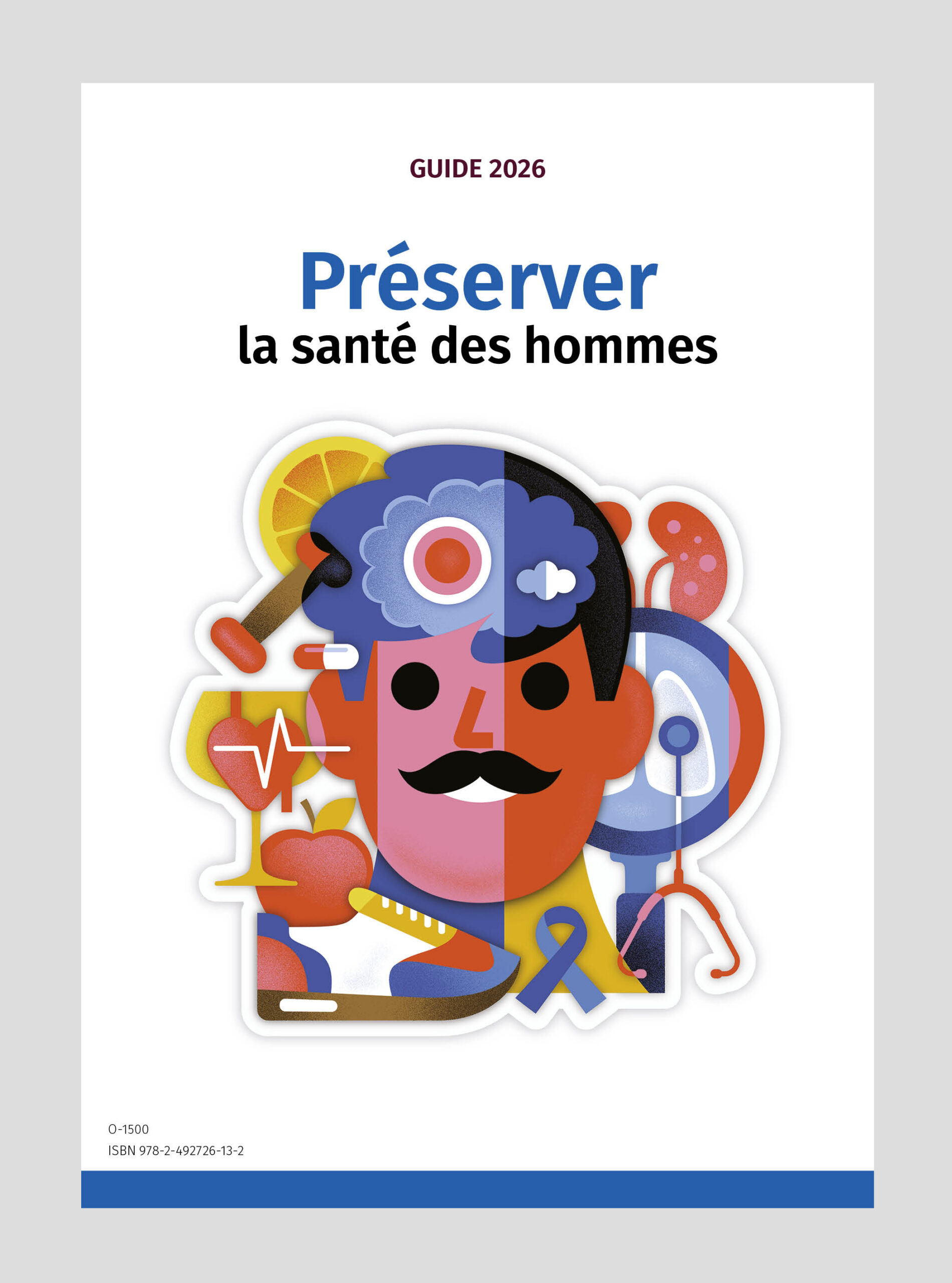Prendre en charge les douleurs neuropathiques
Liées à une lésion nerveuse, les douleurs neuropathiques se manifestent par des sensations de brûlure, des décharges électriques, des picotements et une hypersensibilité au toucher ou au froid. Comment les atténuer ? Les réponses d’un spécialiste.
Environ 7 % des Français souffriraient de douleurs dites neuropathiques, selon l’étude STOPNEP. « Il s’agit de douleurs liées à l’atteinte d’une structure nerveuse aux nombreuses origines comme la sciatique, le zona, la sclérose en plaques, le diabète, un traumatisme entraînant une blessure nerveuse, une intervention chirurgicale, une tumeur, etc. », explique le Professeur Julien Nizard, chef du service douleur, soins palliatifs et de support, médecine intégrative au CHU de Nantes. Ces douleurs peuvent concerner une zone du corps très localisée ou beaucoup plus étendue et sont chroniques et rebelles aux traitements antalgiques habituels. Survenant également durant la nuit, elles se manifestent par des brûlures, des décharges électriques, des démangeaisons, des picotements, des sensations de froid douloureuses et des fourmillements. « Elles sont parfois mal diagnostiquées et confondues avec des douleurs nociceptives (douleurs liées à la stimulation d’une zone précise du corps). Pourtant deux examens permettent d’identifier ces douleurs neuropathiques : l’électromyogramme qui mesure les vitesses de conduction nerveuse et l’IRM de la zone concernée, qui permet d’examiner avec attention les structures nerveuses atteintes », précise le professeur.
Médicaments et thérapies psychocorporelles
La prise en charge de ce type de douleur repose en premier lieu sur le traitement de leur cause. Mais il existe des traitements, médicamenteux ou non, souvent efficaces pour les soulager. « Si la douleur neuropathique est localisée, on peut utiliser la neurostimulation transcutanée, un petit appareil qui la réduit grâce à l’envoi d’impulsions électriques de part et d’autre du trajet des nerfs concernés. Il existe aussi des patchs à la lidocaïne, un anesthésique local, ou des patchs qui contiennent une haute concentration de capsaïcine (dérivée du piment) et qui sont posés dans le cadre d’une hospitalisation de jour », détaille le Pr Nizard. « Si la douleur est généralisée, il existe des médicaments comme l’amitriptyline, un antidépresseur, ou des antiépileptiques comme des gabapentinoïdes.Enfin, en troisième ligne, on peut avoir recours à la stimulation magnétique transcrânienne qui stimule les zones du cerveau impliquées dans l’inhibition de la douleur, ou encore la stimulation médullaire [NDLR : voir notre article page 10]. La morphine n’est plus prescrite qu’en dernier recours en raison notamment du risque de dépendance et de perte d’effet lors de la prise au long cours qui l’accompagne », souligne-t-il tout en insistant sur l’importance des thérapies non médicamenteuses. Une activité physique adaptée est ainsi particulièrement conseillée à ces patients car le sport possède un effet inhibiteur de la douleur grâce à la sécrétion d’endorphines. Les techniques psycho corporelles ont aussi fait leurs preuves. « On peut proposer des techniques d’hypnose ou de relaxation. L’acupuncture donne aussi régulièrement de bons résultats. La douleur chronique entraînant souvent un repli sur soi et une certaine exclusion sociale, nous essayons d’encourager nos patients à avoir des activités occupationnelles, sociales et professionnelles adaptées », ajoute le spécialiste.
Enfin, la prise en charge psychologique joue un rôle primordial. « Les douleurs neuropathiques provoquent parfois une altération importante de la qualité de vie, d’autant qu’elles ont souvent une composante nocturne et qu’elles surviennent sans prévenir. Certains patients sont parfois au bord du suicide et il est donc capital de traiter la composante émotionnelle de la douleur et l’anxiété ou la dépression induites », note le Pr Julien Nizard. Il existe différentes approches mais les thérapies cognitives et comportementales (TCC) ont prouvé leur efficacité dans cette indication.
Violaine Chatal