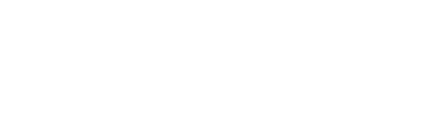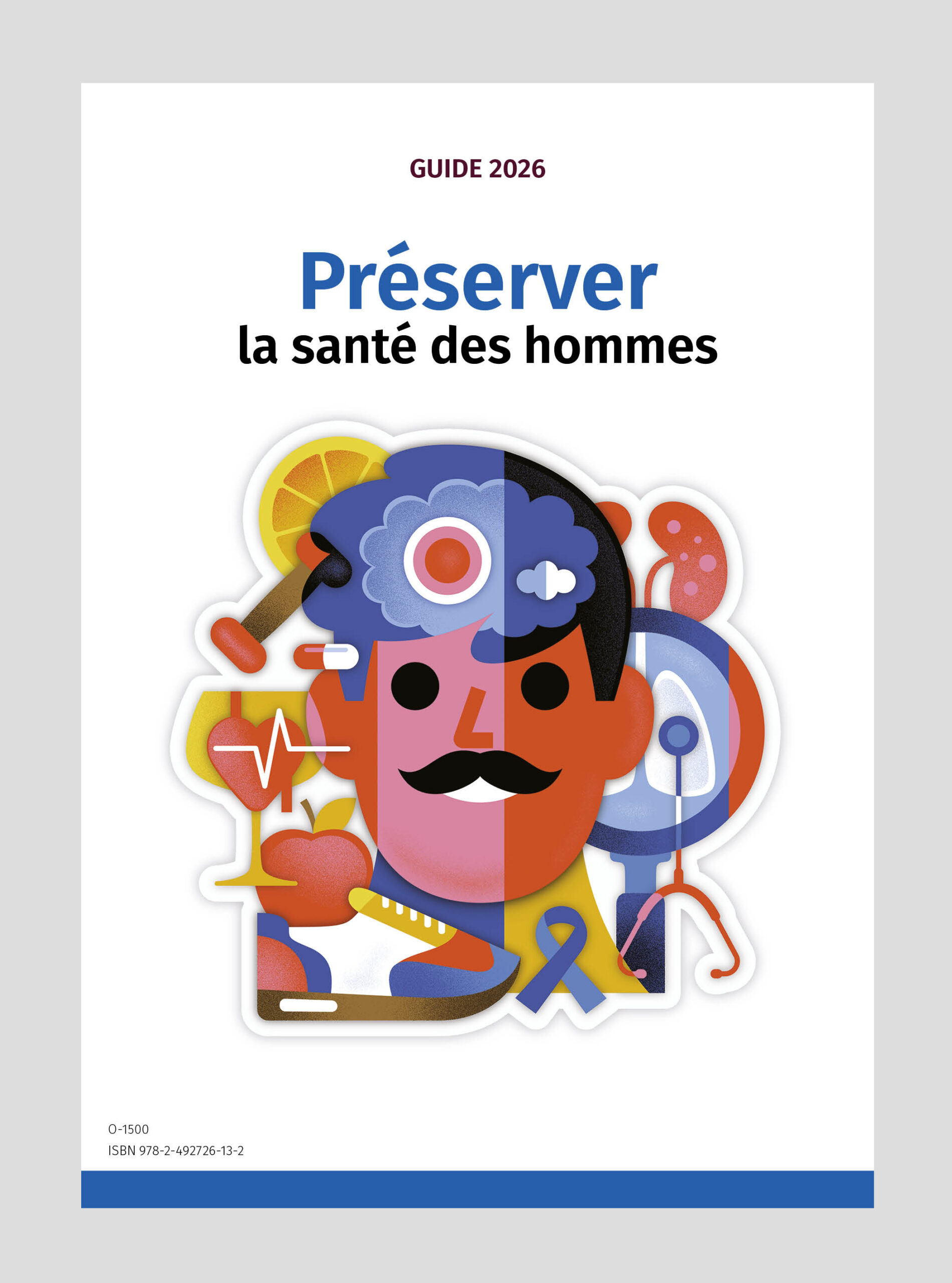Sida : malgré des avancées majeures, la vigilance reste de mise
La Journée mondiale de lutte contre le Sida, ce 1er décembre, est l’occasion de rappeler que l’épidémie persiste. Et ce, malgré les progrès qui ont permis de réduire drastiquement les nouvelles infections au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les inégalités d’accès aux soins et de la stigmatisation sont en cause.
Célébrée chaque année le 1er décembre (lire aussi notre article), la Journée mondiale de lutte contre le Sida est un temps fort de la prévention de la maladie. Le syndrome d’immunodéficience acquise (Sida) survient lorsque l’ensemble des défenses du corps humain sont détruites par le VIH. Aujourd’hui, des traitements permettent d’empêcher la multiplication du virus et donc éviter d’arriver au stade du Sida
Le VIH est toujours là
Pour autant, le VIH est toujours une menace. En France, près de 170 000 personnes vivent avec le virus. Chaque année, environ 6 500 nouvelles contaminations sont détectées. Une personne peut être contaminée par voir sexuelle, lors de rapports non protégés. Le contact peut également avoir lieu par voie sanguine, lors d’un accident d’exposition au sang d’une personne contaminée et non traitée. Mais cela est heureusement rare dans l’Hexagone. Enfin, l’infection peut survenir lorsque l’on partage du matériel lié à l’usage de drogue, comme des seringues.
En revanche, et contrairement à certaines idées reçues, il n’y a pas de risque de transmission par la salive ou la sueur, par contact avec des objets ou par piqûre de moustiques.
Des progrès à poursuivre
Depuis 2010, les efforts au niveau mondial ont permis de réduire de 40 % le nombre de nouvelles infections par le VIH, indiquent l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans le même temps, les décès liés au Sida ont chuté de plus de moitié. Les traitements antirétroviraux ont transformé la vie des personnes séropositives, leur offrant une charge virale indétectable. Pourtant, comme le rappelle António Guterres, secrétaire général de l’ONU, « pour de nombreuses personnes dans le monde, la crise n’est pas finie ». « Des millions d’entre elles n’ont toujours pas accès aux services de prévention et de traitement du VIH en raison de leur identité, du lieu où elles vivent ou de la stigmatisation qu’elles subissent », constate-t-il.
De l’importance du préservatif
Car pour lutter contre le VIH qui provoque le Sida, la prévention est la clé. Le préservatif est en cela indispensable. Il est une barrière mécanique contre le virus. Accessible facilement, il présente l’avantage d’être utilisables par tous quel que soit son âge, et à tout moment.
En France, des préservatifs peuvent être délivrés gratuitement aux jeunes de moins de 26 ans en pharmacie et sans ordonnance. Pour les 26 ans et plus, certains sont remboursés par l’Assurance maladie à hauteur de 60 % mais sur prescription médicale cette fois-ci.
De plus, les centres de santé sexuelle (CSS), les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd), les associations, ou encore les infirmeries des établissements scolaires en distribuent aussi gratuitement.
En complément, il existe des traitements préventifs. La prophylaxie pré-exposition, appelée Prep, s’adresse aux personnes présentant un risque d’exposition au virus. Le traitement post-exposition (TPE) peut, quant à lui, être prescrit en cas de potentielle exposition. Délivrés sur ordonnance, la Prep et le TPE sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie.
Dépister et traiter précocement pour éviter le Sida
Par ailleurs, le dépistage constitue un pilier essentiel contre le développement du Sida (lire aussi notre article). Il permet de détecter la présence d’anticorps anti-VIH dès trois semaines après la contamination. Pour cela, il suffit de se rentre en laboratoire pour réaliser sans frais, sans rendez-vous et sans ordonnance une prise de sang.
D’autres types de tests sont disponibles. Il y a le test rapide d’orientation diagnostique (Trod), accessible auprès des associations ou des Cegidd. Et l’autotest qui, lui, se trouve en pharmacie et auprès des associations. Tous deux permettent d’avoir un résultat en 30 minutes grâce au prélèvement d’une goutte de sang au bout du doigt ou du fluide sécrété par le tissu gingival. Mais, ils ne sont fiables que trois mois après la possible exposition au VIH.
Une fois le diagnostic posé, les traitements antirétroviraux sont proposés. Souvent administrés sous forme de trithérapie, ils visent à réduire la charge virale jusqu’à la rendre indétectable. Cependant, ils ne permettent pas encore de guérir totalement.
En finir avec le Sida d’ici 2030
L’objectif est donc de mettre toutes ces armes à la disposition de tous (lire aussi notre article). Pour António Guterres, « mettre fin au Sida en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030 » est un objectif « à notre portée ». Pour y arriver, il estime qu’il faut investir dans la prévention et l’élargissement de l’accès aux traitements. Il veut aussi « allier l’innovation à l’action » afin que de nouvelles solutions soient développées. Enfin, il rappelle que ces actions doivent être fondées « sur les droits humains afin que personne ne soit laissé pour compte ».