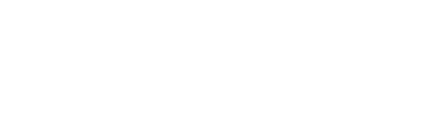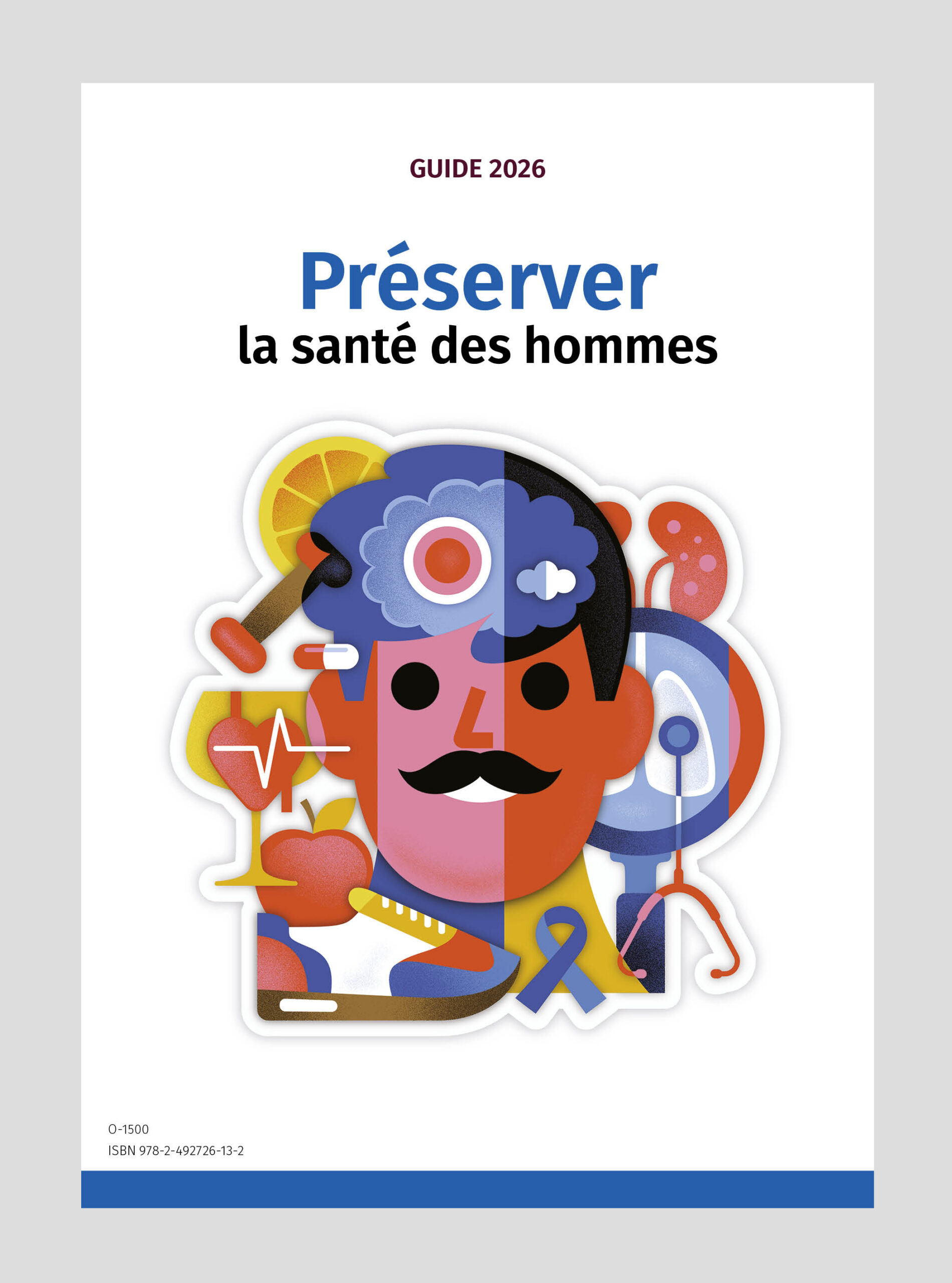Suzanne Noël, pionnière engagée de la chirurgie esthétique
Première femme à pratiquer la chirurgie esthétique moderne, Suzanne Noël était également une féministe convaincue. Elle s’est battue toute sa vie pour que les femmes puissent disposer de leur corps et de leur vie, convaincue que la chirurgie pouvait aider à cette émancipation.
1878 : Les débuts en médecine
Suzanne Noël voit le jour sous le nom de Suzanne Gros le 19 janvier 1878 à Laon. Elle est issue de la petite bourgeoisie du Nord. Quatrième d’une fratrie dont les trois aînés sont décédés à la naissance, elle connaît une enfance difficile. Son père, sellier, meurt alors qu’elle n’a que 6 ans et elle grandit seule avec sa mère. Elle épouse à 19 ans le dermatologue Henry Pertat et déménage à Paris. Elle s’ennuie et veut passer son baccalauréat qu’elle obtient à l’âge de 25 ans en 1902. Elle s’inscrit ensuite en faculté des sciences. Elle entame des études de médecine avec l’accord de son mari. Celui-ci est indispensable à une époque où très peu de femmes exercent cette profession. Elle se passionne pour la dermatologie et la chirurgie. Nommée au concours d’externe des hôpitaux trois ans plus tard, elle fait son premier stage dans le service d’Hippolyte Morestin, pionnier de la chirurgie maxillo-faciale. L’opération à succès qu’il réalise, d’une enfant défigurée par une cicatrice, la bouleverse et elle décide de devenir chirurgien esthétique. En 1909, elle rejoint le service de dermatologie du professeur Louis Brocq à l’hôpital Saint-Louis et réalise ses premiers actes de chirurgie esthétique sur des volontaires.
1912 : Premier lifting pour Sarah Bernhardt
Encore interne, elle exerce sous l’autorité de son mari. Elle rencontre (au culot) Sarah Bernhardt. Cette dernière vient d’être opérée par le Dr Charles Miller, à Chicago. Ce chirurgien américain a rehaussé la partie supérieure de son visage pour effacer les signes du temps. Mais il n’est pas intervenu sur le bas du visage ! La jeune femme propose alors à la légendaire tragédienne de remédier à cette dissymétrie en utilisant des pinces pour remonter les chairs, les découper en lambeaux et les cacher derrière les oreilles. Cette méthode sera ensuite connue sous le nom de lifting. Convaincue par les arguments de Suzanne, Sarah Bernhardt accepte sa proposition. L’intervention a lieu sous anesthésie locale. La jeune femme travaille à mains nues, sans masque ni blouse stérile, mais ses doigts agiles font des merveilles et c’est un succès. La comédienne remonte rapidement sur scène avec un visage visiblement plus jeune. Suzanne Noël passe l’internat des hôpitaux. Elle est reçue en 1912 après avoir obtenu la meilleure note à l’écrit. Elle commence à réaliser de petites interventions esthétiques et réparatrices à l’hôpital Saint-Louis et propose, dans son appartement parisien, des opérations de chirurgie ambulatoire sans anesthésie et en particulier des liftings du visage. Novatrice, elle effectue ces actes de chirurgie avec des instruments qu’elle a elle-même mis au point.
1916 : L’effort de guerre
La jeune femme rejoint Hippolyte Morestin au Val-de Grâce et va l’aider à réparer les « gueules cassées » de retour de la guerre. Le chirurgien commence les « autoplasties par jeu de patience » qui consistent à rassembler tous les morceaux brisés d’os et de chair afin de reconstituer des visages et effectue les premières greffes de peau et d’os. Suzanne, qui fréquente beaucoup les musées pendant son temps libre, se révèle experte dans l’art de recréer des traits harmonieux. Son mari meurt après avoir inhalé les gaz de combat sur le front belge lors de la Première Guerre mondiale. Un an plus tard, Suzanne se remarie avec André Noël, rencontré lors de ses études de médecine. Mais, en 1922, leur fille, Jacqueline, meurt de la grippe espagnole. Désespéré, André Noël plonge dans la dépression et finit par se jeter dans la Seine sous les yeux de sa femme, la laissant criblée de dettes.
1923 : L’engagement féministe
Suzanne Noël lance une manifestation pour appeler les femmes qui travaillent à ne pas payer d’impôts puisque l’État ne leur reconnaît aucun droit. À l’instar de sa consœur Nicole Girard-Mangin (célèbre pour avoir été l’unique femme médecin à exercer au sein de l’armée française durant la Première Guerre mondiale), elle se déclare ouvertement suffragette et inscrit sur son chapeau et sa veste : « Je veux voter ». Elle est alors contactée par deux Américaines fondatrices d’un club féminin appelé les Soroptimist. Deux ans plus tard, elle fonde le premier club français qui a pour vocation de défendre les droits des femmes et de favoriser leur émancipation. Parallèlement, elle devient également l’ambassadrice de l’association Les P’tits Quinquins qui permet aux enfants issus du nord de la France, de partir en colonie de vacances.
1926 : La chirurgie esthétique et son rôle social
Dans son cabinet ou à la clinique des Bleuets, la chirurgienne reçoit des femmes d’affaires, des artistes, mais aussi des employées ou des ouvriers. Engagée, elle fait payer ses patients selon leurs moyens et opère souvent gratuitement. « La chirurgie esthétique m’apparut dès lors comme un véritable bienfait social permettant aussi bien aux hommes qu’aux femmes de prolonger leurs possibilités de travail de manière inespérée », écrit-elle dans son livre La chirurgie esthétique, son rôle social paru en 1926. Elle réalise des liftings et invente la technique de dégraissage par aspiration, la future liposuccion, ce qui lui permet d’affiner des bras, des fesses et des ventres. Elle fait aussi des merveilles concernant les oreilles décollées et les poches sous les yeux. Avec son confrère Raymond Passot, elle contribue à rendre légitime la chirurgie esthétique en France, jusque-là dépréciée.
1928 : La Légion d’honneur
En 1928, elle reçoit la Légion d’honneur pour sa contribution à la notoriété scientifique de la France sur la scène internationale. Opérée de la cataracte, Suzanne Noël comprend qu’elle ne peut plus travailler au même rythme qu’avant. Elle se consacre alors aux clubs Soroptimist et voyage à travers le monde pour ouvrir de nouvelles antennes tout en donnant des conférences sur sa pratique de la chirurgie esthétique. Elle traverse ainsi 14 fois l’Atlantique !
1944 : Actes de bravoure
Sous l’occupation elle transforme les visages de résistants ou de juifs recherchés par la Gestapo. Après la guerre, elle reçoit des rescapés des camps afin d’effacer les stigmates de l’horreur sur leur peau. Elle meurt à son domicile parisien à l’âge de 76 ans, le 11 novembre 1954. Suzanne Noël est inhumée avec sa fille Jacqueline et son deuxième mari André Noël au cimetière de Montmartre.
Violaine Chatal
Source : podcast de France Culture Suzanne Noël, pionnière féministe de la chirurgie esthétique.
La dignité des « gueules cassées »
L’expression « gueules cassées » désigne les survivants de la Première Guerre mondiale qui ont subi des blessures au niveau du visage lors des combats. Au sortir de la guerre, la France compte en effet un peu moins de 4 millions de blessés. 500 000 d’entre eux souffrent de plaies de la face, du nez, des yeux et des oreilles et surtout de fractures des maxillaires, en particulier du maxillaire inférieur. Le pronostic vital de ces gueules cassées n’est pas engagé mais leurs souffrances morales liées au préjudice esthétique sont énormes. C’est pour les aider à retrouver un semblant de dignité que Suzanne Noël se battra toute sa vie.