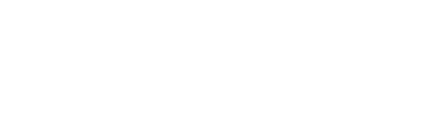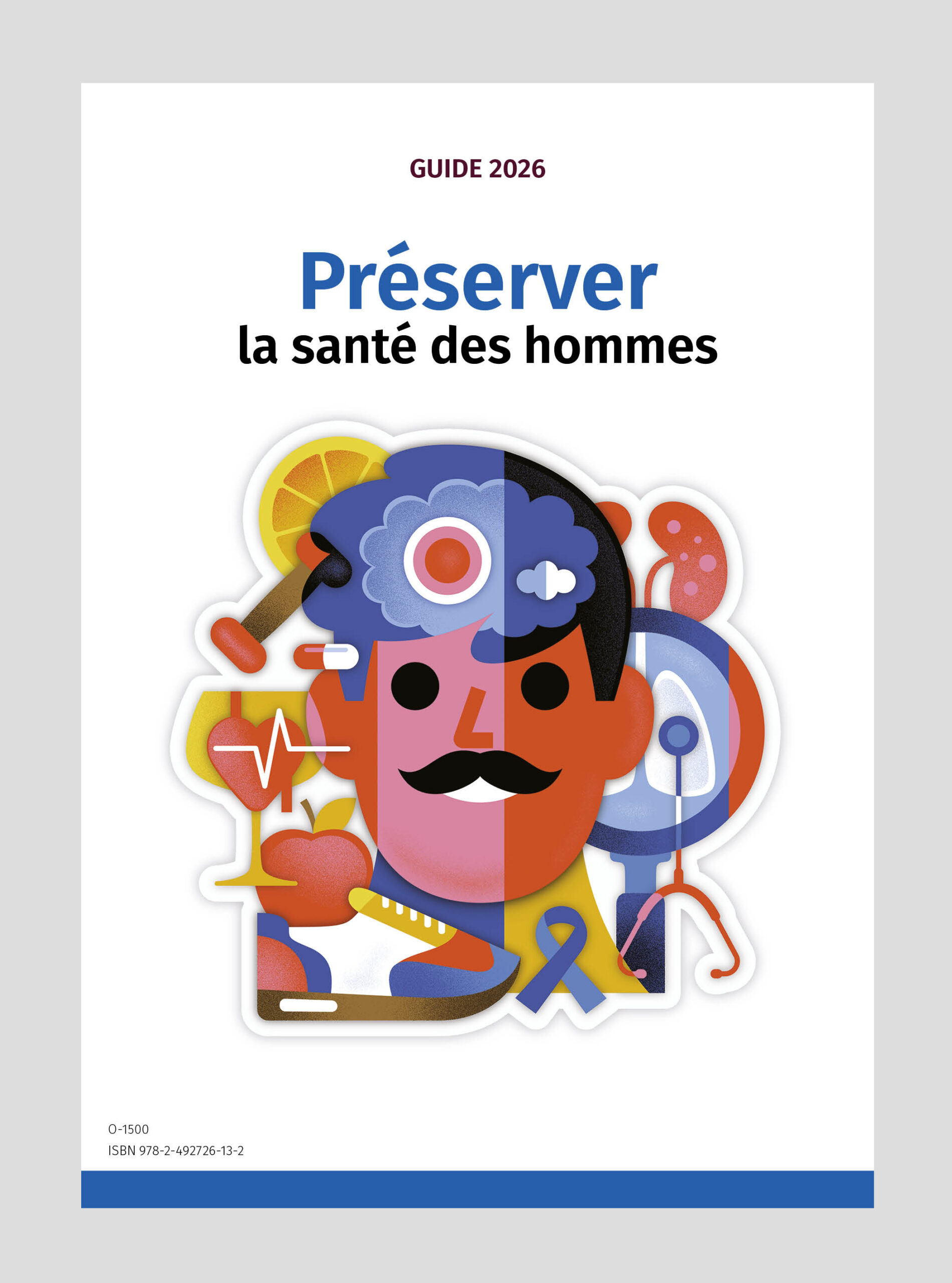Tuberculose pulmonaire : une nouvelle stratégie de dépistage
La Haute autorité de santé a récemment mis à jour les stratégies de dépistage de la tuberculose pulmonaire ciblant les populations à risque. L’objectif étant à la fois de détecter rapidement les personnes atteintes mais aussi de limiter la propagation de la maladie.
En France, le taux d’incidence de la tuberculose pulmonaire est relativement faible, puisqu’il est inférieur à 10 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, certains groupes spécifiques sont plus à risques de la développer. La Haute autorité de santé (HAS), saisie par le ministère chargé de la Santé, a donc fait évoluer sa stratégie de dépistage. Le but étant de permettre une détection précoce et efficace auprès des populations à risque.
La tuberculose pulmonaire : une maladie infectieuse
La tuberculose est une maladie infectieuse qui se transmet par voie aérienne (toux, expectorations, éternuements…). Elle touche le plus souvent les poumons (lire à ce sujet notre dossier) aussi bien des enfants que des adultes. Selon la HAS, une personne atteinte peut contaminer en moyenne 10 à 15 personnes par an.
Selon les cas, la pathologie peut évoluer d’un stade non infectieux à infectieux, avec ou sans symptômes, et mettre ainsi en danger les personnes infectées et leur entourage. « Non traitée, la tuberculose peut entraîner le décès », rappelle l’institution dans son communiqué.
Qui sont les populations à risque ?
Certaines personnes, en raison de leurs conditions de vie ou de leurs déterminants sociaux, sont plus susceptibles de contracter la maladie. Il s’agit des « populations précaires sans domicile fixe, vivant dans des lieux de promiscuité (établissement pénitentiaire, foyer collectif, squat), issues d’un pays à forte incidence de tuberculose (migrants) ou ayant des facteurs de risque médicaux à l’origine d’une altération des défenses immunitaires », développe l’autorité publique. Ces dernières sont, du reste, généralement plus éloignées du système de santé, rendant alors le dépistage et le traitement plus difficiles à mettre en place.
Deux nouveaux programmes de dépistage précoce
Les programmes de dépistage actuellement proposés comportent des lacunes. La HAS relève en effet une « hétérogénéité des pratiques et des moyens selon les départements, les structures et les types de populations cibles ». À cette limite organisationnelle s’ajoute le manque de communication et de formation des professionnels. Par ailleurs, le délai trop long entre la réalisation d’examens et leurs résultats peut amener à perdre la personne dépistée.
L’autorité publique a alors repensé son système de dépistage précoce, en proposant deux types de programmes.
Le dépistage dit systématique concerne d’abord les migrants (du nourrisson à l’adulte) entrés en France depuis 2 ans ou moins et issus d’un pays où la tuberculose enregistre une forte incidence, supérieure ou égale à 100 pour 100 000. Les adultes et adolescents ayant fait un séjour à l’étranger de plus de 6 mois dans un pays à forte endémie, qui vivent dans la promiscuité ou en contact avec des personnes infectées, seront également dépistés. Ce programme vise aussi les personnes incarcérées (et celles sorties de prisons depuis moins de 2 ans).
D’un autre côté, le dépistage opportuniste cible les personnes sans-abri ou sans domicile fixe, celles ayant une mobilité internationale et vivant en communauté isolée, les personnes vulnérables, précaires, en marge du système de soins et celles vivant dans la promiscuité. Il s’adresse à la fois aux adultes et aux adolescents. Des algorithmes standardisés y sont associés, afin de guider les professionnels de santé dans la conduite à tenir.
Former et informer
En parallèle, la HAS recommande de sensibiliser et former les professionnels en contact avec ces populations. Elle défend également une approche globale, en préconisant par exemple un dépistage conjoint du VIH, de l’hépatite C, B et de la tuberculose pour les étudiants étrangers, les personnes vivant dans un squat et les détenus entrant en maison d’arrêt.
L’institution s’inscrit également dans une démarche de prévention. Elle prône à ce titre la mise en place d’actions « aller vers » et la création de « supports d’information adaptés traduits en différentes langues ». Elle préconise aussi le renforcement de l’information sur la vaccination contre la tuberculose (BCG, pour bacile de Calmette et Guérin) des personnes à risque d’exposition.