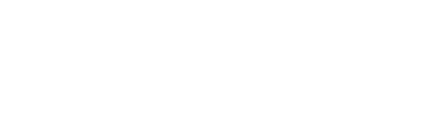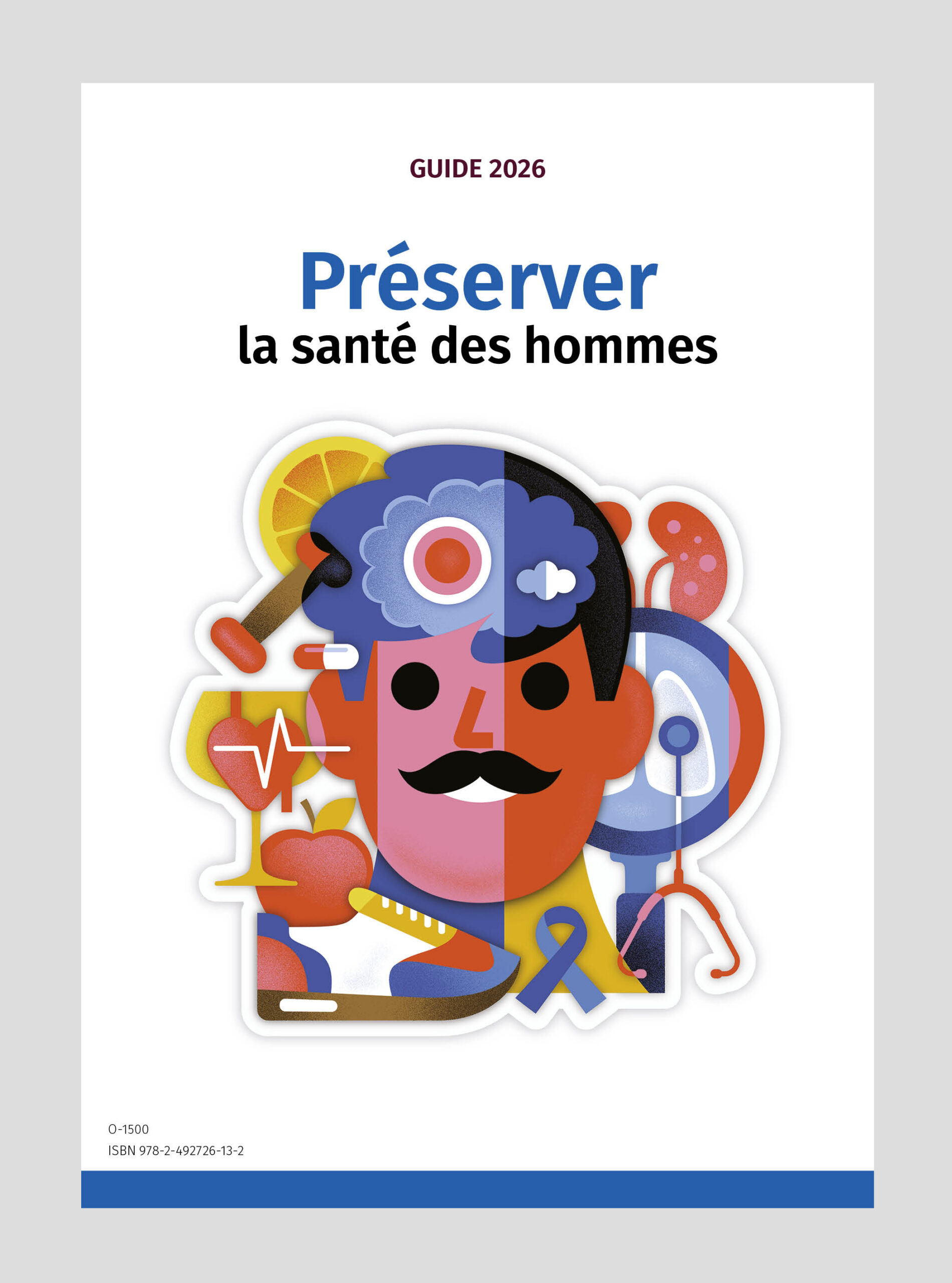Dépenses de santé : qui participe à leur financement ?
En France, le poids des dépenses de santé sur le budget des ménages varie selon leur niveau de vie et leur statut socioprofessionnel, démontre une nouvelle étude. Mais certaines situations peuvent soulever des questions quant à l’équité de notre système de santé.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) s’est intéressée au financement des dépenses de santé par les Français. Son étude, publiée le 28 août, révèle l’effort supporté par les différents types de ménages dans le pays.
6 800 euros par ménage et par an
En 2019, la santé représente en moyenne 15 % du revenu des ménages, soit environ 6 800 euros par an. À titre de comparaison, le budget consacré à l’alimentation s’élevait à 4 400 euros en 2017. Derrière ce poste de dépense important se cachent différents prélèvements. D’abord, les cotisations sociales et taxes qui financent l’assurance maladie obligatoire, à hauteur de 11 %. Il s’agit des cotisations sociales maladie et de la contribution sociale généralisée (CSG). S’ajoutent aussi les taxes sur la consommation (comme la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA).
Les primes d’assurance versées aux complémentaires santé sont également comprises dans ce poste (lire aussi notre article sur les taxes des contrats santé). Elles comptent pour 3 % des revenus. Enfin, le reste à charge est quant à lui évalué à 1 %.
Derrière ces taux moyens, il existe pourtant des disparités importantes. En effet, pour 10 % des ménages, la santé pèse 23 % de leurs revenus. De plus, pour 1 % d’entre eux, ce taux atteint même 34 % des revenus.
Les actifs financent plus les dépenses de santé
Les actifs en emploi sont surreprésentés parmi les ménages pour lesquels la santé pèse le plus lourd dans le budget. De fait, ils constituent les trois quarts des 10 % de ménages les plus prélevés.
« Les salariés et indépendants contribuent davantage au financement de l’assurance maladie obligatoire que les autres ménages, du fait de l’importance des cotisations maladie retenues sur les revenus d’activité, qui s’ajoutent à la CSG et aux taxes sur la consommation », constate l’institution. Ces derniers ont toutefois un niveau de vie médian ou aisé « car les taux de cotisation sont plus élevés sur les hauts salaires », ajoute-t-elle.
En parallèle, on observe une surreprésentation des personnes modestes parmi le 1 % de ménages qui contribuent le plus. Elles sont soit confrontées à des dépenses de santé mal remboursées ou bien ont des revenus faibles. « Un poids extrême de la santé dans le revenu est supporté par des ménages souvent modestes, parfois retraités, et souffrant plus fréquemment d’une affection de longue durée », confirme la Drees.
Les retraités aisés moins sollicités
À l’opposé, « les retraités très aisés ne consacrent que 11 % de leur revenu à la santé », observent les auteurs de l’étude. Ce taux grimpe à 18 % chez les actifs en emploi avec un niveau de vie équivalent. En cause : les cotisations sociales maladies retenues sur les revenus d’activité. Pour les ménages très modestes, l’effort est similaire entre actifs et retraités (respectivement 15 % et 14 %).
« Au total, alors que le poids de la santé dans le revenu augmente en moyenne avec le niveau de vie pour les actifs en emploi, il diminue pour les retraités », conclut la Drees.
Aller vers plus d’équité dans le financement des dépenses de santé ?
Ces informations rappellent que le financement de la santé en France, bien que solidaire, génère aussi des inégalités. Alors que les actifs en emploi supportent un effort progressif, les ménages modestes peinent à absorber le coût des soins. Cette étude « interroge la mise en œuvre des principes d’équité de la Sécurité sociale, souvent résumés sous la formule “De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins” », estime la Drees. Une réflexion pour garantir l’équité pour tous devrait donc être menée.