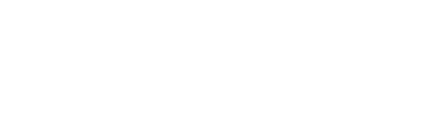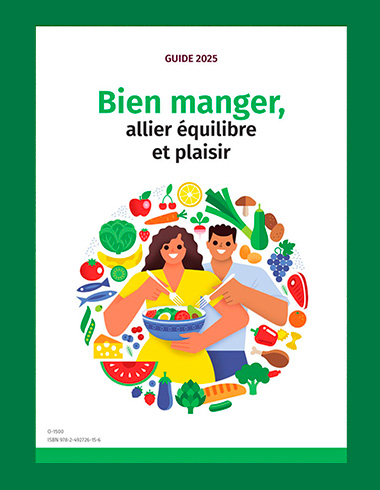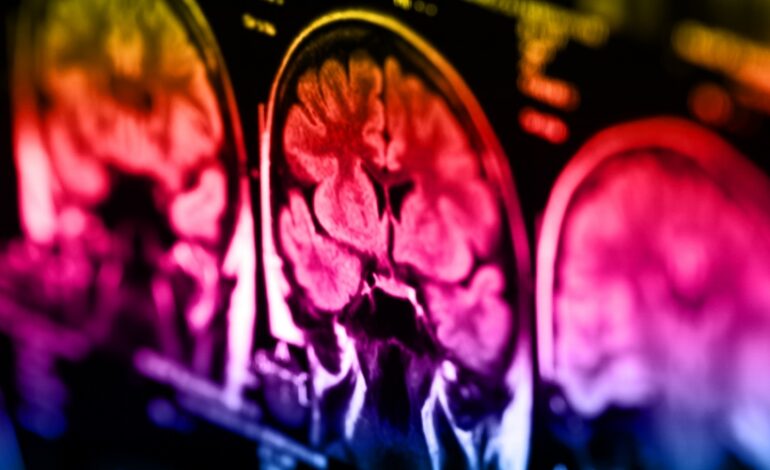Qualité de l’air dans les logements : des polluants persistent
La deuxième Campagne nationale sur la qualité de l’air dans les logements, menée par l’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, livre ses premiers résultats. Si une nette amélioration est constatée depuis 2005, certains polluants restent préoccupants. Décryptage.
L’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs (OQEI), porté par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses) vient de publier la deuxième Campagne nationale logements (CNL2) sur la qualité de l’air en France. Mise en œuvre entre 2020 et 2023, cette dernière s’inscrit dans une démarche de long terme. L’objectif est « d’assurer un suivi de l’évolution de la qualité des environnements intérieurs, où nous passons une grande partie de notre temps », précise l’Anses dans un communiqué.
Une enquête de grande ampleur
Les résultats portent sur les résultats relatifs aux composés organiques volatils (COV) et semi-volatils (COSV), le dioxyde d’azote (NO2), les particules fines (PM2,5) et le radon. Les initiateurs ont mesuré plus de 170 polluants dans 571 logements (appartement et maisons) et plus de 300 communes. Par ailleurs, 1 513 personnes ont été interrogées. « La méthodologie d’enquête permet d’extrapoler les résultats à l’échelle du parc de 30 millions de résidences principales en France hexagonale », assure l’Anses. Cette étude regroupe, de plus, différentes données : caractéristiques du bâti, mesures de qualité de l’air au domicile des participants, informations sur les habitudes domestiques (travaux, ménage, tabagisme…), etc. Autant d’éléments qui fournissent des données fiables pour alimenter les politiques publiques de santé environnementale.
Des avancées significatives portées par les politiques publiques
Premier constat positif : la qualité de l’air intérieur s’est nettement améliorée depuis la première campagne de 2003-2005. En 15 ans, les concentrations de nombreux composés organiques volatils, aldéhydes (une catégorie de COV) et particules dans l’air ont significativement chuté. On note par exemple une baisse de plus de 80 % pour certains solvants chlorés (1,4-dichlorobenzène, trichloroéthylène et tétrachloroéthylène). L’étude mesure également une diminution de 33 % des particules fines, les PM2,5, liées notamment au tabagisme et au trafic routier (lire aussi notre article). La baisse est de 47 % pour le benzène, associé au trafic routier également et aux activités de combustion un polluant, reconnu comme cancérogène.
Ces progrès s’expliquent principalement par l’évolution de la réglementation. Les interdictions de certaines substances et les étiquetages obligatoires des produits de constructions ont eu des effets sur la pollution. La réduction du tabagisme et les actions de réduction des émissions de polluants dans l’air ambiant ont également porté leurs fruits ; Enfin, les actions de sensibilisation de la population et des professionnels à la qualité de l’air intérieur menées depuis 2005 prouvent leur efficacité.
Des polluants préoccupants dans certains logements
Malgré ces avancées, une proportion significative de logements présente encore des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs de référence sanitaires. Ainsi, 70 % des logements enregistrent un taux de particules fines trop élevé. La concentration de radon est, par ailleurs, au-delà de la valeur réglementaire dans près de 8 % des cas. De plus, 6 % des logements ne respectent pas la valeur de formaldéhyde. Enfin, le benzène et le dioxyde d’azote sont également concernés, mais dans une minorité de cas (respectivement 1,4 et 0,05 % des logements).
Certains composés, potentiellement cancérogènes, comme le benzène ou le tétrachloroéthylène, appellent ainsi à une vigilance accrue. Et ce, d’autant plus que pour de nombreux polluants, aucune valeur de référence n’existe à ce jour.
Guider les politiques à venir
Les données récoltées dans le cadre de cette campagne vont désormais alimenter des études plus ciblées. Elles concernent la ventilation, l’humidité, les moisissures ou encore l’impact sanitaire et économique de la pollution intérieure. « Ces premiers résultats de la CNL2 illustrent parfaitement la vocation de l’OQEI, opéré par l’Anses et le CSTB, de mettre à disposition des connaissances fiables sur les environnements intérieurs pour alimenter l’action publique, la réflexion citoyenne et la communauté scientifique », se réjouissent Éric Vial et Julien Rogé, pilotes de l’OQEI. Parallèlement, l’Anses prévoit de publier avant la fin de l’année des résultats sur la présence des pesticides dans l’air intérieur et dans les poussières, autre sujet de préoccupation croissante.