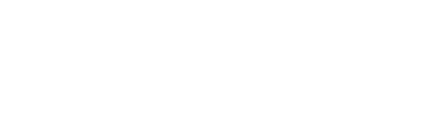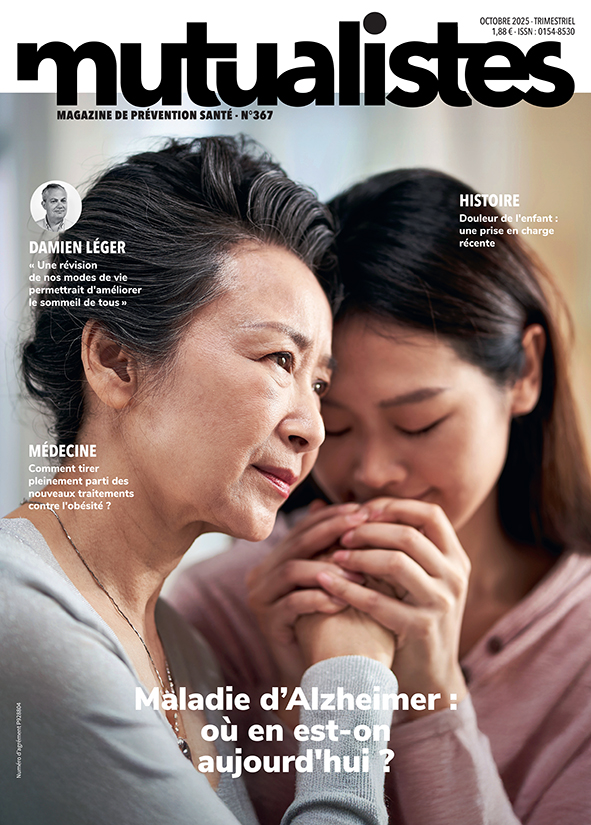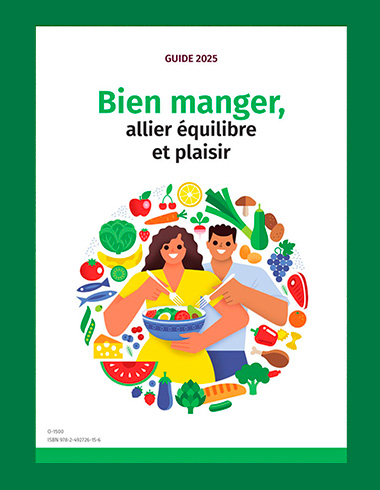« Une révision de nos modes de vie permettrait d’améliorer le sommeil de tous »
Damien Léger est spécialiste des rythmes et des troubles du sommeil, chef de service du Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu université de Paris-Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP) et auteur de La France insomniaque.
Les Français dorment de moins en moins, et de plus en plus mal. Or, un bon sommeil est fondamental pour rester en bonne santé. Bien que préoccupante, cette situation ne serait pas irréversible. Pour le professeur Damien Léger, il est temps de faire du sommeil une véritable priorité de santé publique.
Les Français dorment-ils moins bien qu’avant ?
C’est incontestable. Nous assistons aujourd’hui à une épidémie de « sommeil court ». Près d’un tiers des Français dort moins de 6 heures par nuit les jours de travail, contre 17 %
il y a dix ans. Cela touche notamment les femmes, plus sujettes à l’insomnie, et les personnes âgées, puisque l’âge agit sur la qualité de sommeil. Depuis le Covid-19, on constate également une hausse conséquente des insomnies chez les jeunes de 18 à 35 ans, dépassant celle constatée chez les personnes plus âgées.
Quelles sont les principales causes de cette dégradation du sommeil ?
Elles sont nombreuses. Il y a déjà les rythmes de travail, et principalement ceux liés au travail de nuit, qui influent énormément sur le sommeil des personnes concernées. Ces dernières dorment en moyenne une heure de moins par nuit que les personnes qui travaillent la journée. Cela correspond à une nuit entière par semaine, et entre 30 et 40 nuits par an !
De plus, les personnes travaillent plus loin de leur domicile. Elles se lèvent donc plus tôt et se couchent plus tard, perdant ainsi du temps de sommeil. Il y a aussi l’utilisation excessive des écrans et des réseaux sociaux, surtout le soir. La pollution lumineuse a également des conséquences : 50 % des Parisiens n’ont même plus besoin d’allumer la lumière chez eux la nuit, tant la ville est éclairée. Or, la lumière perturbe notre horloge biologique, même à travers les paupières.
Les inégalités sociales se reflètent aussi dans le sommeil. Logements plus exigus, bruit, stress… tout ceci constitue des facteurs aggravants. Le changement climatique joue également un rôle : pour bien dormir, en effet, il faut perdre un degré de température corporelle. Or, les nuits trop chaudes rendent cela plus difficile. Une température nocturne de plus de 25 °C multiplie par 3,5 le risque de dormir moins de sept heures par nuit.
Enfin, le contexte et l’éco-anxiété, notamment chez les jeunes, influe profondément sur le sommeil. Nos études menées durant le Covid-19 l’ont confirmé : chaque annonce forte et anxiogène (confinement, fermeture des écoles…) était suivie d’un pic de mauvais sommeil et d’anxiété chez les Français interrogés.
Quels sont les troubles du sommeil les plus fréquents ? Et comment se définissent-ils ?
L’insomnie est le trouble le plus répandu, puisqu’elle concerne 15 à 20 % des adultes en France. Elle se caractérise par une difficulté à l’endormissement (plus de 30 minutes) et/ou au maintien du sommeil (un réveil au moins 3 fois par nuit avec des difficultés pour s’endormir), avec un possible réveil précoce, au moins 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois. Le syndrome d’apnée du sommeil est un autre trouble fréquent. Il s’agit d’arrêts respiratoires nocturnes pendant au moins 10 secondes, minimum 10 fois par heure, avec des conséquences sur la saturation en oxygène dans le sang et une fatigue en journée. Il existe aussi des troubles plus rares comme la narcolepsie ou le somnambulisme.
Pourquoi le sommeil est-il si essentiel pour notre santé ?
Le sommeil est fondamental pour notre survie. Il régule les fonctions cardiaques et respiratoires, participe à la récupération musculaire et à la production d’hormones. Il occupe aussi un rôle immunitaire, dans la lutte contre les petits cancers par exemple, et énergétique, notamment pour conserver une température constante. Il agit également sur le plan psychologique (apprentissage, mémoire, humeur, etc.). Un mauvais sommeil déséquilibre ces fonctions et augmente aussi les risques de diabète, de surpoids et d’accidents.
Que faire si l’on souffre de troubles du sommeil ?
Généralement, les gens vont voir un médecin pour une cause spécifique, et profitent de cette consultation pour évoquer leur trouble de sommeil, à la fin. Or, cela constitue un motif à part entière. Nous conseillons de prendre rendez-vous avec son généraliste, et de lui présenter un agenda du sommeil (horaires de coucher, éveils, qualité perçue…) sur deux à trois semaines. Il pourra ensuite orienter vers une consultation spécialisée en centre du sommeil par exemple.
Quels conseils simples peut-on appliquer au quotidien pour mieux dormir ?
Il faut créer un environnement favorable au sommeil : température fraîche (environ 19 °C), chambre calme, sombre et accueillante, lit confortable, horaires réguliers, écrans éteints au moins une heure avant le coucher, pas de sport tardif, repas léger et peu d’alcool et un moment détente (lecture, musique douce…). Je dis souvent que le sommeil est une chance. Il faut donc lui redonner une valeur positive. Je recommande par exemple de se préparer à bien dormir au moins 3 à 4 soirs par semaine. L’idée est de se mettre en condition et s’accorder du temps pour passer une bonne nuit.
Les navigateurs solitaires ou les militaires apprennent à gérer leur sommeil différemment. Peut-on en tirer des enseignements ?
Leur sommeil est entraîné et organisé pour maintenir une efficacité optimale. Même si dormir de manière fragmentée peut fonctionner ponctuellement, à long terme, cela n’est pas durable. Cependant, on sait qu’un bon sommeil, les jours précédant un événement important, peut améliorer la concentration et la performance.
Et les somnifères, dans tout ça ?
Ils peuvent s’avérer utiles en cas de dépression, de maladie, ou dans une période difficile. Mais ils ne doivent être qu’un recours temporaire, prescrit par un médecin, et surtout pas en automédication. D’autres approches peuvent être intéressantes, comme la luminothérapie qui consiste à s’exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche pour réguler notre horloge biologique ou encore la pleine conscience, qui se caractérise par un état de concentration sur le moment présent.
La sieste est-elle recommandée ?
Oui ! Une courte sieste de 15 à 20 minutes, réalisée entre 13 et 15 heures, est très bénéfique pour la vigilance, la mémoire, et la performance. Certains métiers et pays l’autorisent déjà. Chez les enfants aussi, la sieste a toute sa place, jusqu’en classe de CP. Elle ne doit cependant pas être trop tardive ni trop longue, au risque de tomber dans un sommeil profond, qui rend alors le réveil plus compliqué.
Les troubles du sommeil sont-ils, selon vous, un vrai enjeu de santé publique ?
Absolument. Et malheureusement, ils sont encore trop banalisés. On a parfois le sentiment que les autorités sanitaires baissent les bras. Pourtant de vraies réflexions pourraient être lancées pour améliorer le sommeil des Français, à commencer par le travail de nuit. Ce dernier pourrait, par exemple, être limité aux métiers d’urgence (santé, sécurité, etc.). Les centres commerciaux doivent-ils par exemple être ouverts jusqu’à minuit ? De même pour l’éclairage nocturne. Même si c’est joli, les monuments n’ont pas forcément besoin d’être éclairés toute la nuit. Prenons aussi exemple sur certaines communes qui mettent en place des éclairages publics intelligents qui détectent les mouvements des piétons et varient ainsi l’intensité lumineuse. Cela permet d’allier sécurité, économie d’énergie et qualité de vie.
Il y a aussi la question du bruit. Des couvre-feux ont déjà été mis en place dans les aéroports. Le niveau sonore des sirènes des transports d’urgence pourrait par exemple être baissé la nuit, quand il y a moins de circulation. Une révision de nos modes de vie permettrait d’améliorer le sommeil de tous.
Propos recueillis par Constance Périn