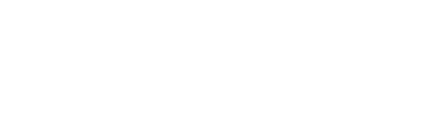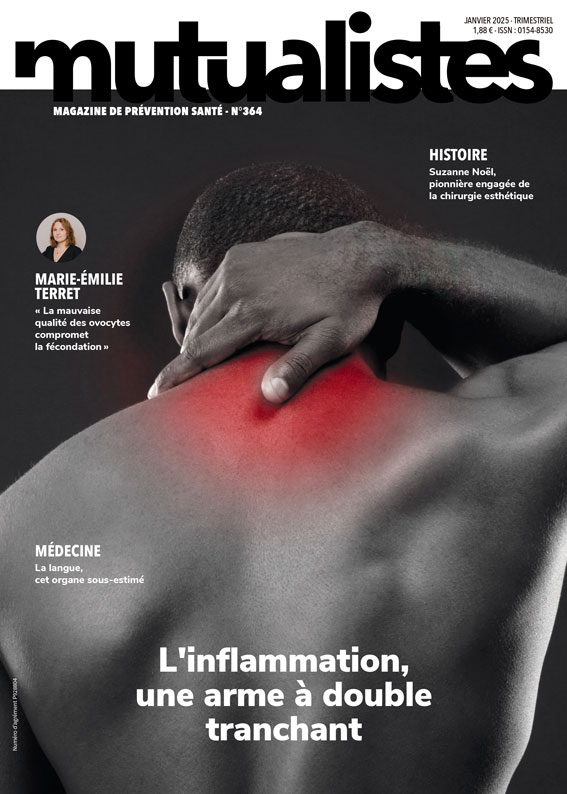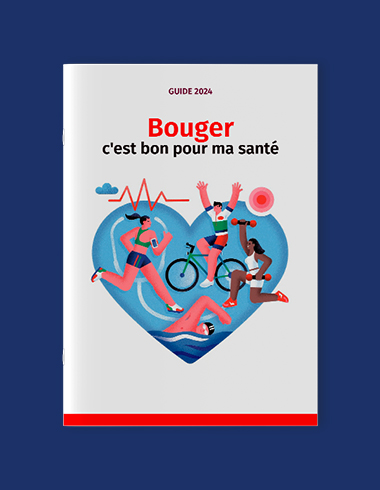Vrai ou faux ? Tout savoir sur l’accident du travail
Que savez-vous réellement sur l’accident du travail ? Définition, procédures, conséquences, reprise du travail… on fait le point sur ces éléments essentiels.
Un accident du travail entraîne forcément une lésion.
Vrai. C’est même l’un des critères de l’accident du travail. Pour être qualifié comme tel, l’événement doit avoir provoqué une lésion physique (malaise, coupure, brûlure, douleur musculaire, voire décès) et/ou psychologique, comme un choc émotionnel. L’accident doit, bien sûr, avoir eu lieu dans le cadre du travail mais aussi à une date précise.
Un accident entre deux lieux de travail n’est pas considéré comme un accident du travail.
Faux. Si un salarié est victime d’un accident lors d’un déplacement professionnel – un commercial qui conduit entre deux clients, par exemple –, il s’agit d’un accident du travail.
Un accident de trajet, quant à lui, intervient notamment entre le lieu de travail et le domicile (résidence principale, secondaire ou lieu fréquenté dans la vie courante). Le trajet doit alors être le plus direct possible mais peut malgré tout comprendre certains arrêts (à la boulangerie, à l’école…).
L’employeur peut contester son caractère professionnel.
Vrai. En effectuant la déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou dans les dix jours qui suivent, l’employeur peut émettre des réserves. Celles-ci doivent être « motivées », c’est-à-dire portée sur « des faits étayés par des éléments objectifs », précise l’Assurance maladie. La CPAM entame ensuite une investigation et constitue un dossier sur lequel le salarié et l’employeur peuvent transmettre des observations. Une fois cette étape terminée, la CPAM rend sa décision et reconnaît, ou non, l’accident du travail.
La faute inexcusable de l’employeur peut être invoquée.
Vrai. La faute inexcusable est reconnue lorsque l’employeur a exposé son salarié à un danger dont il avait, ou aurait dû, avoir conscience et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires.
C’est au salarié d’en apporter la preuve. Cette reconnaissance peut lui permettre de prétendre à une majoration de sa rente en cas d’incapacité ou à une indemnisation des préjudices subis.
L’accident du travail met fin au contrat de travail.
Faux. Lorsqu’il engendre un arrêt, l’accident du travail a pour effet de suspendre le contrat. Le salarié continue ainsi de faire partie de l’effectif de l’entreprise mais il est dispensé d’exécuter ses tâches. Il ne peut pas non plus travailler chez un autre employeur ou pour son propre compte. De son côté, l’employeur ne peut pas lui demander de réaliser de missions en présentiel ou en télétravail.
L’accident du travail ouvre droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux.
Vrai. La victime d’un accident du travail bénéficie d’une prise en charge intégrale, à 100 %, des actes médicaux nécessaires à son traitement, dans la limite toutefois des tarifs de base de l’Assurance maladie. Elle est également dispensée d’avancer les frais.
La visite de préreprise est obligatoire.
Faux. La visite médicale de préreprise, lors d’un arrêt de plus de 30 jours ou en cas de reprise anticipée, est facultative. Elle permet cependant d’anticiper le retour sur le poste de travail et, notamment, de réaliser des aménagements. Cette visite peut avoir lieu à la demande du salarié, de son médecin traitant, des services médicaux de l’Assurance maladie ou du médecin du travail. Le salarié peut, par ailleurs, solliciter un rendez-vous avec le médecin du travail à tout moment, même pendant son arrêt de travail.
Enfin, la visite de reprise est quant à elle obligatoire. Elle doit être réalisée dès le retour en poste ou dans les huit jours qui suivent. C’est elle qui met fin à la suspension du contrat de travail.
Léa Vandeputte
À lire : Guide pour les victimes d’accidents du travail et leurs familles, Direction générale du travail (DGT), avril 2024. Téléchargeable sur
Travail-emploi.gouv.fr.